LE DROIT DE GRÂCE
Du latin « gracia », la
grâce est une faveur que l’on fait sans y être obligé ; une bonne
disposition ou encore une bienveillance. Pour les théologiens, elle est un secours
divin, un don surnaturel que Dieu accorde en vue du salut. Cependant, quand
elle est empruntée de la linguistique par la science juridique (c’est
d’ailleurs l’aspect juridique de cette notion qui retiendra notre attention
tout le long de cette réflexion), la grâce devient un acte (juridique) de
clémence par lequel un chef d’Etat décide souverainement de dispenser
totalement ou partiellement un condamné (dans son Etat) de l’exécution de sa
peine. Autrement dit, dans ce cas, la grâce est une dispense partielle ou
totale d’exécution d’une peine ou une commutation (remplacement) d’une peine
par une autre plus légère, par mesure de clémence.
Si l’on fait remonter l’origine de la
« grâce » à la naissance des premiers contrats sociaux (conformément
à la thèse du Contrat social défendue par Jean-Jacques Rousseau en 1762), le
droit de grâce naîtrait avec l’apparition des premiers gouvernements.
Toutefois, s’il faut exclure le conditionnel pour ne s’en tenir qu’aux événements certains,
nous affirmerons que les preuves de l’existence du droit de grâce ont été
retrouvées sous l’Ancien régime français (1515-1789). Il sera néanmoins
hasardeux d’affirmer- sans preuve supplémentaire- que cette prérogative est née en France. En
réalité, elle ne serait pas inconnue de plusieurs royaume et empire avant même
l’avènement de la première mondialisation en 1870. C’est dire que le
droit de grâce est un droit qui ressemble fort bien à un droit naturel des
souverains d’antan (rois, empereurs,….) quelle qu’en soit leur situation
géographique (Afrique, Amérique, Asie, Europe,…). D’ailleurs cette thèse
(l’existence très ancienne de la grâce) est corroborée par les Saintes
écritures bibliques (Matthieu 27 : 16-26 / Marc 15 : 7-15/ Luc
23 : 17-25) qui nous relatent de forte et belle manière l’exercice du
droit de grâce par un représentant du souverain de Rome en Palestine:
Ponce Pilate. En effet, elles décrivent la libération d’un repris de justice
(Barrabas) au détriment d’une autre personne (Jésus de Nazareth). Ce récit qui
habituellement peut être rangée dans la catégorie des mythes religieux peut
servir dans un travail scientifique comme le nôtre, (depuis la récente
découverte des manuscrits de la Mer morte datée de près de deux mille ans et
relatifs aux récits des Évangiles), ne serait-ce que pour démontrer l’origine
très ancienne du droit de grâce.
Très souvent, la grâce est confondue malencontreusement
à une autre notion qui lui est voisine : l’amnistie. En vérité, il existe,
sous certains angles, un fossé entre ces deux notions. La grâce est un acte du
pouvoir exécutif (un décret, le seul qui n’est pas publié au Journal Officiel)
tandis que l’amnistie émane du pouvoir législatif (elle est donc une loi). De
plus, dans leur effet, l’amnistie, est un pardon général, un oubli total des
crimes dans un but de « réconciliation nationale » alors que la grâce
absout son bénéficiaire de la peine sans pour autant l’effacer.
Il convient de se demander, dans
l’optique de mieux la cerner, que retenir de la grâce.
L’analyse révèle que la grâce est une
pratique établie et encadrée quoique sujette à polémique. Voilà pourquoi les
controverses dont elle est l’objet seront abordées (II) à la suite de la partie
consacrée à son institution (I).
I- Le droit de grâce, une pratique instituée
Il
existe aujourd’hui un véritable encadrement du droit de grâce (B) du fait qu’il
est passé de l’informel au formel (A).
A- De l’informel au formel
Constitutionnalisé
de nos jours (2), le droit de grâce a incontestablement une origine coutumière
(1).
1- L’origine coutumière du droit de grâce
L’exercice
du droit de grâce est une tradition très ancienne, héritée de la période
glorieuse des monarchies. En effet, même si l’on ne sait avec exactitude à
quand remonte la naissance de ce droit, il est quand même certain qu’il est
connu des sujets ayant vécu dans lesdites monarchies très anciennes.
D’ailleurs, à voir de près, ce droit (celui de grâce) sied plus aux gouvernants-souverains
du passé qu’aux gouvernants-modernes, bien évidemment, d’aujourd’hui ;
puisque l’exercice de ce pouvoir ressemble plus à un absolutisme, un
« fait du Prince » qu’à un acte démocratique en phase avec les
grandes tendances du monde libérale actuel. On peut aisément affirmer que c’est
une pratique qui, tant bien que mal, a traversé le temps et mieux, se trouve
conférer une valeur constitutionnelle dans la plupart des États modernes.
2- La constitutionnalisation du droit de grâce
Le
droit de grâce n’a pas échappé à la fièvre de constitutionnalisation qu’a
connue le siècle des Lumières (1715-1789). En effet, la plus ancienne
constitution encore en vigueur, celle des États-Unis d’Amérique énonce à l’alinéa premier de la section 2 de son article
2 que : « Le Président […] aura le pouvoir d’accorder des sursis et
des grâces pour crimes contre les États-Unis, sauf dans le cas
d’impeachment ». Vu que cette constitution américaine, adoptée en 1787, et
ratifiée en 1788, nous pouvons affirmer avec assurance qu’aux États-Unis, le
droit de grâce a été élevé au rang constitutionnel en 1788.
Sous
la Vème République en France, le droit de grâce a aussi une valeur
constitutionnelle. Présent dès 1958, l’article 17 de la Constitution française
révisée en 2008 dispose que « Le Président de la République a le droit de
faire grâce à titre individuel. ».
Loin
d’être le propre du monde occidental, cette pratique est aussi
constitutionnalisée dans les pays africains. Tel est le cas du Togo où
l’article 73 dispose que « Le Président de la République exerce le droit
de grâce après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. ».
De
nos jours, le droit de grâce, cette pratique constitutionnalisée est encadrée.
B- L’encadrement juridique du droit de grâce
Les
conditions d’exercice(1) et les effets (2) du droit de grâce seront tour à tour
abordés.
1- Les conditions d’exercice du droit de grâce
Le
droit de grâce, en fonction du régime politique de chaque pays, appartient soit
au Président ou soit au Roi.
Dans
la plupart des États, ce droit appartient exclusivement au Chef de l’État. Dans
les États-fédérés (comme aux États-Unis, l’Allemagne,…) le Chef de l’État
fédéral partage cette prérogative avec les Chefs des entités fédérées. La
question du titulaire de ce droit élucidé, il convient d’aborder celle des
conditions d’exercice.
En
réalité, le droit de grâce ne peut être exercé que lorsque les recours
judiciaires sont épuisés. Voilà pourquoi il est surnommé le recours de la
dernière chance. On en déduit que nul ne peut être gracié pour une affaire
toujours en instance judiciaire. Outre cette exigence ayant un caractère quasi
général, il y a, en fonction des pays, des spécificités. C’est le cas en France
où depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le Président de la
République n’a plus le droit de gracier collectivement. Ce droit, en l’état
actuel du droit constitutionnel français, ne peut donc être accordé qu’à titre
individuel.
La
dernière grande condition est celle relative au crime ou délit commis par la
personne à gracier. Pour user du droit de grâce, le titulaire doit s’assurer
que la sanction infligée à celui/celle qu’on veut gracier est judiciaire et non
administrative. Il est à souligner que quelque soit la peine judiciaire, un
condamné peut bénéficier du droit de grâce.
Cela
dit, il convient de signaler que le droit de grâce relève des pouvoirs
discrétionnaires de son titulaire. C’est dire que le Chef de l’État est libre de
gracier ou de refuser de gracier. Dans les deux cas, il n’est pas tenu de
justifier son choix.
Au
demeurant, notons que la grâce peut être sollicitée par le condamné, sa
famille, ses proches, une association ou le procureur de la République. Cependant,
même accordée par l’autorité compétente, un condamné a le droit de refuser la
grâce (à lui accordée). Tel fut le cas en France où Guillaume Seznec (condamné
pour meurtre en 1924) a refusé une grâce
présidentielle en 1933.
2- Les effets du droit de grâce
Si
elle n’est pas refusée par celui/celle à qui elle est accordée, la grâce
(présidentielle ou royale) dispense totalement ou partiellement un condamné de
l’exécution de sa peine quelle qu’en soit la lourdeur de celle-ci. C’est pour
cela qu’on affirme que la grâce est une mesure de clémence qui supprime ou
modère la peine qu’un condamné aurait dû subir. Cependant, contrairement à
l’amnistie, la grâce ne fait pas disparaître la condamnation du casier
judiciaire du condamné.
Malgré
sa constitutionnalisation, le droit de grâce demeure un privilège régalien
contesté.
II- La grâce, une pratique controversée
Malgré
les arguments avancés par ceux qui contestent le bien fondé du droit de grâce
de nos jours (A), d’autres trouvent des
vertus à cette prérogative (B).
A- La thèse des pourfendeurs du droit de grâce
Le
principe de la séparation des pouvoirs (1) et l’égalité des citoyens devant la
loi (2) sont convoqués par les pourfendeurs du droit de grâce.
1- Le droit de grâce, une estocade au principe de la séparation des pouvoir
L’argument
majeur qu’avance ceux qui contestent l’existence du droit de grâce dans la
démocratie moderne telle qu’on les a aujourd’hui est l’estocade qu’il
porterait, à l’indépendance de la justice et par ricochet, au principe de la
séparation des pouvoirs.
En
réalité, amorcé par des brillants auteurs tels qu’Aristote, John Locke et
Marcel de Padou, la paternité du principe de la séparation du pouvoir est
attribué au bordelais Charles Louis de SECONDAT alias Charles de MONTESQUIEU.
Ce
principe prône une séparation horizontale des pouvoirs dans l’État donnant
ainsi naissance aux pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire (il convient de
dire juridictionnelle de nos jours).
A
travers l’exercice du droit de grâce, selon ces penseurs, on assiste à l’immixtion
de l’exécutif dans le judiciaire. Selon eux, la possibilité d’enfermer, de
condamner et de libérer doit appartenir exclusivement aux juges (pouvoir
juridictionnel). Or par le sésame du droit de grâce, l’exécutif opère une
pénétration dans la sphère du juridictionnelle d’où la nécessité de mettre à
mort ce droit.
2- La rupture de l’égalité des citoyens devant la loi
Leur
second argument est l’injustice que créerait le droit de grâce. En effet, ils
estiment, en s’appuyant sur le principe d’égalité des citoyens devant la loi,
que cette prérogative est contraire aux textes juridiques (Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme de 1948 et plusieurs constitutions) qui
consacrent l’égalité des citoyens au sein de l’État. La grâce présidentielle
accordée à Paul TOUVIER, ancien chef de la milice lyonnaise sous l’occupation,
a apporté du grain à moudre aux pourfendeurs de cette prérogative. Selon eux,
cela dénote du caractère archaïque de cette prérogative qui n’est plus en phase
avec les exigences de la démocratie telle que pensée dans le monde actuel. D’ailleurs
le mécontentement populaire qu’a suscité ce triste usage de ce droit (la grâce) par le président
Georges POMPIDOU en 1971 (affaire Paul TOUVIER précitée) a fait dire à
plusieurs que cette prérogative est tout
simplement anachronique.
B- La thèse des défenseurs du droit de grâce
Le
droit de grâce est nécessaire (1) et très salutaire en cas d’erreur judiciaire
(2).
1- La grâce, un droit régalien nécessaire
Dans
certaines situations difficiles, il arrive que les victimes aient recours au
crime de façon volontaire ou involontaire pour se libérer de leurs agresseurs.
Tant que leurs actes ne répondent pas aux critères de la légitime défense, ces
victimes sont traitées conformément à la rigueur de la loi. La grâce, dans ces
cas, joue un rôle réparateur.
L’émouvante
grâce accordée en 1996 à Véronique AKOBE (en France) par le Président Jacques
CHIRAC en est une parfaite illustration. En vérité, cette domestique ivoirienne
est condamnée à vingt (20) ans de prison en 1990 pour avoir grièvement blessé
son patron et tué le fils de celui-ci. Or il s’est révélé durant les
interrogatoires que dame Véronique AKOBE fut sauvagement violentée sexuellement
par son patron et le fils de celui-ci sans que la dame n’est la possibilité
d’opposer son refus. Par ailleurs, ces sévices sexuels ont eu lieu à plusieurs
reprises jusqu’à ce que exaspérée, dame AKOBE ne réagisse (certes
illégalement). Sa condamnation fut perçue par l’opinion publique comme étant un
couteau remué dans sa plaie, une injustice. C’est donc tout logiquement que le
public a accueilli cette annonce avec beaucoup de soulagement.
Tout
récemment, ce fut la réconfortante et médiatisée grâce accordée par le
Président François HOLLANDE à dame Jacqueline SAUVAGE ( le 31 janvier 2016) qui
a soulagé l’opinion publique française et internationale.
La
grâce peut être aussi accordée pour des raisons médicales (le cas du général
TIDJANI au Togo) ou dans un but d’ « apaisement politique »
comme ce fut le cas le 29 novembre 2017 au Togo avec la libération du Dr SAMA,
secrétaire général d’un parti politique de l’opposition.
2- La grâce, un droit salutaire en cas d’erreur judiciaire.
Tant
que les juges resteront des humains, il arrivera toujours des erreurs
judiciaires. En réalité, une erreur judiciaire est une « erreur de fait commise
par une juridiction de jugement dans son appréciation de la culpabilité d’une
personne poursuivie » (Gérard Cornu, Vocabulaire juridique, Paris, 2005,
p.363). On peut déduire de cette définition que pour qu’on puisse reconnaître
l’existence d’une erreur judiciaire, il faut qu’une juridiction, qui a eu
connaissance de l’affaire puisse déceler cette erreur et la neutraliser. C’est
donc l’autorité judiciaire elle-même qui reconnaît l’existence d’une erreur
judiciaire (En France, la justice a reconnu onze erreurs judiciaires depuis
1945.).
Donc, s’il n’y a pas eu reconnaissance par la
justice de sa propre erreur, aucun procès en révision ne peut aboutir quelle
qu’en soit la preuve apportée par le condamné. La grâce devient, dans cette
situation, ce précieux sésame par lequel ces injustices peuvent être corrigées.
L’illustration parfaite nous vient de l’Etat de l’Illinois où le gouverneur
George Ryan a gracié des condamnés à des peines de mort puisqu’il était évident
aux yeux de tous que leur responsabilité n’était pas suffisamment prouvée. Tout porte à
croire que pour bien de temps encore, le droit de grâce restera debout !
©
Abel KLUSSEY, juriste et politologue
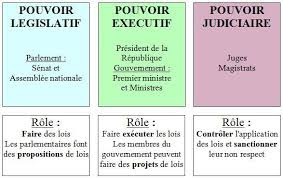


Commentaires
Enregistrer un commentaire