L’Ethique dans l’arbitrage OHADA : Etude à la lumière du nouvel Acte Uniforme relatif au droit de l’Arbitrage et du nouveau Règlement d’Arbitrage de la CCJA
Introduction
L’arbitrage,
véritable justice privée a longtemps été considéré comme un no man’s land éthique, favorisant
l’accroissement et la multiplication des dérives dont se rendent coupables les
divers acteurs intervenant dans la procédure arbitrale. Face à cela on assiste
depuis quelques années à un retour en force de la morale au premier plan des préoccupations de l’époque sous la forme de l’éthique1 tendant à réparer les dérives constatées en matière arbitrale. C’est
alors qu’il parait judicieux de mener une réflexion sur l’éthique dans
l’arbitrage OHADA à l’heure actuelle où s’est opérée une mise à jour des textes
régissant le droit de l’arbitrage dans l’espace OHADA.
L’éthique est,
à la fois, la sœur jumelle de la morale et l’amie de la déontologie. En premier
lieu elle est la sœur jumelle de la morale
du fait que ce sont deux mots étymologiquement très proche. La morale
est tournée vers le for intérieur de l’individu laissé devant sa bonne ou
mauvaise conscience. Elle est à cheval entre le bien et le mal tandis que
l’éthique, tournée vers l’extérieur2 distingue clairement
ce qui est bon de ce qui est mauvais et est considérée comme une morale
collective3. L’éthique est donc, selon la définition du
Professeur TERCIER « ce qui se fait ou ce
qui ne se fait pas, ce qui doit se faire ou ne pas se faire. Elle s’adresse
à tous les intervenants au processus arbitral
: les arbitres, mais aussi les parties, leurs conseils et les
centres d’arbitrage »4.Le Doyen Cornu
définit l’éthique comme étant l’ « ensemble
de principes et valeurs guidant
des comportements sociaux
et professionnels, et inspirant
des règles déontologiques ou juridiques »5.
Cette dernière définition confirme d’ailleurs en second lieu les liens d’amitié6 qui lient la morale et la déontologie qui quant
à elle regroupe pour les personnes exerçant une même activité, les règles
juridiques et morales qu’elles ont le devoir de respecter.
L’OHADA, est une institution sous régionale d’intégration juridique entre
ses pays membres visant à assurer une sécurité juridique aux transactions
économiques qui s’y opèrent ainsi qu’à faciliter les échanges et
l’investissement. Comptant de nos jours dix-sept (17) Etats parties7, elle est une institution originale8 africaine instituée par le Traité
relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique signé à Port-Louis le 17 Octobre 1997 et
révisé au Québec le 17 octobre 2008. Afin d’atteindre ses missions et
objectifs, l’OHADA procède par l’adoption d’Actes Uniformes (ci-après AU) qui
sont des règles juridiques communes répondant aux réalités économiques des
états membres et adaptés à l’environnement économique international. Directement applicables dans les Etats parties9, les AU sont
au nombre de dix (10) et sont consacrés à de diverses matières en lien avec le
droit des affaires. C’est à cet effet que l’on retrouve au sein de l’arsenal
juridique propre à l’OHADA un AU relatif au droit de l’arbitrage adopté à
Ouagadougou le 11 mars 1999, révisé le 23 novembre 2017 qui régit la matière
arbitrale en droit OHADA.
L’arbitrage est un « mode dit
parfois amiable ou pacifique, mais toujours juridictionnel de règlement d’un
litige par une autorité qui tient son pouvoir de juger non d’une délégation
permanente de l’Etat ou d’une institution internationale, mais de la convention
des parties »10.
Dans le cadre de l’OHADA, l’arbitrage est soit ad hoc ou institutionnel. Il est dit ad hoc lorsqu’il se déroule en dehors du centre
1B. OPPETIT, Philosophie du droit, Dalloz, précis
droit privé 1999, pp.137-138.
2 L’éthique dans l’arbitrage – Colloque international
du 9 décembre 2011, p.2
3 Ibid.
44 Déf proposé au Colloque Francarbi du 09 décembre
2011
5 G. CORNU, vocabulaire juridique, 11em Edition mise à
jour, P.423.
6 Employé dans le domaine
professionnel, on parle souvent d’éthique et déontologie. C’est donc la
constance de l’utilisation souvent cumulative faite de ces deux mots qui livre
le témoignage de leur amitié certaine.
7 Des négociations sont
actuellement en cours pour une adhésion du Maroc.
8 G. POUGOUE, encyclopédie OHADA, p 1313.
9 Article 10 du traité instituant l’OHADA.
10 Op.cit., p78.
d’arbitrage de
CCJA et relève de la seule initiative des parties et de leur arbitre. Il est
alors entièrement organisé par les parties qui désignent les arbitres et
déterminent les conditions de déroulement de la procédure arbitrale11. Il est dit institutionnel lorsqu’il est
organisé par une institution ou centre d’arbitrage conformément au Règlement
d’arbitrage de cette institution, ledit règlement fixant la procédure arbitrale
à suivre12. Dans l’espace OHADA, l’arbitrage
institutionnel est administré par le centre
d’arbitrage de la CCJA. L’arbitrage dans l’espace OHADA tire sa source des dispositions du titre
4 du traité de Port-Louis complété par le Règlement d’arbitrage de la CCJA
(ci-après RA/CCJA), l’AUA, ainsi que des décisions du conseil des ministres de
la CCJA relative au droit de l’arbitrage. Malgré l’existence de ces textes, le
recours est de plus en plus pressant à l’éthique. Cet état des choses
s’explique par les diverses dérives
constatées dans la pratique de l’arbitrage relatives
soit à l’atteinte aux
principes fondamentaux de l’arbitrage, soit à la commercialisation de plus en
plus croissante de l’arbitrage.
L’éthique
arbitrale dans cette logique regroupe un ensemble de valeurs, des devoirs et
des comportements que les différents protagonistes d’une procédure devraient
respecter ou faire respecter pour préserver l’arbitrage de ses abus. Quelles
sont les manifestations théoriques et pratiques de l’éthique dans l’arbitrage
OHADA tendant au renforcement du mécanisme juridique d’éradication des dérives arbitrales ? Quelle efficacité apportent les règles éthiques à la procédure arbitrale, telles qu’elles résultent du nouvel AUA en droit OHADA et le nouveau
RA/CCJA ? Telles
sont les préoccupations qui orienteront la présente réflexion.
En plus de mériter
d’être étudiée du fait du renouvellement récent des principaux textes régissant le droit
de l’arbitrage dans l’espace OHADA, la thématique abordée a le mérite d’avoir
vocation à révéler les contours de la notion d’éthique dans la pratique
arbitrale et à se pencher sur la question de la place qu’occupent les règles éthiques
relevant de la soft law aux
cotés des règles
du droit positif
. Il conviendra alors de passer en revue le contenu (I) de la notion
d’éthique en matière arbitrale avant de se pencher sur la question de son
efficacité (II).
I : L’ETHIQUE, UNE EXIGENCE AU CONTENU VARIABLE
A défaut de
l’existence en droit OHADA d’un code ou d’une charte éthique régissant la
procédure arbitrale et recensant les obligations éthiques pesant sur les
différents acteurs , l’analyse des règles éthiques dans le cadre de cette
section sera faite non seulement sous l’éclairage des dispositions des divers
textes qui encadrent l’arbitrage en droit OHADA, mais aussi par le truchement
d’une distinction entre les acteurs principaux (A) et les acteurs secondaires
(B) du processus arbitral.
A : L’Ethique au regard des acteurs clés de la procédure arbitrale
OHADA
On entend
par acteurs clés, les acteurs
principaux concourant à la mise en place du tribunal
arbitral ainsi qu’à la
conduite du procès arbitral. Il s’agit de l’arbitre (1) ainsi que des parties
et leurs conseils (2).
1 : L’arbitre
L’arbitre est
selon la définition de Gérard Cornu, une personne investie par une convention
d’arbitrage de la mission de trancher un litige déterminé et qui exerce ainsi
en vertu d’une investiture conventionnelle, un pouvoir juridictionnel13 Il est le principal acteur de la procédure
arbitrale et a pour mission de trancher le fond du différend qui lui a été
soumis par les parties. Ses obligations éthiques se rattachent aussi bien à son
statut qu’au déroulement de l’instance arbitrale et se révèlent être plus des
devoirs que des droits s’imposant à lui. A la lumière des dispositions du
nouveau RA /CCJA datant du 23 novembre 2017, nombreuses sont les obligations
qui pèsent sur l’arbitre.
Faisant office
d’un juge dans la résolution du conflit qui lui a été soumis par les parties,
l’arbitre doit répondre aux exigences liées à l’exercice de la fonction
juridictionnelle d’un juge. Il doit pour ce faire se vêtir d’une double armure
d’indépendance et d’impartialité qui sont de nature à le prémunir contre
d’éventuels liens personnels aussi bien directs qu’indirects avec les parties
impliquées à la procédure arbitrale. C’est à juste titre que le RA/CCJA prévoit
que « tout arbitre nommé ou confirmé par
la Cour
11 Yves GUYON in L’arbitrage,
Economica-Droit poche, p. 10.
12 Ibid.
13 G. Cornu, Vocabulaire juridique, PUF, 2017, p. 79.
doit être et demeurer
indépendant et impartial
vis-à-vis des parties
»14. L’indépendance et l’impartialité
semblent être des notions qui s’imbriquent l’un dans l’autre,
mais ce sont des notions
bien distinctes. La première se réfère à l’absence de lien entre l’arbitre et les parties
de nature à ce que l’arbitre puisse jouir
d’une liberté et d’une autonomie dans l’exercice de sa mission tandis que
l’impartialité se réfère à une indépendance
d’esprit qui se manifeste par une absence
d’idées préconçues. L’arbitre
impartial est donc celui qui fait preuve d’objectivité
au moment de rendre sa sentence et dont l’opinion est préalablement neutre de telle sorte
que les parties
au litige puisse
s’inter changer sans que sa décision ne soit ébranlée15. On dit de ce fait qu’il est désintéressé du
fait que la sentence ne lui rapportent rien et ne lui nuise en rien, le
laissant ainsi ‘’indifférent’’16.
Les exigences relatives à l’indépendance et à l’impartialité de l’arbitre
sont primordiales et mesurées à l’aune des révélations qu’il est tenu de faire
avant sa désignation par les parties. En effet, l’arbitre est tenu à un devoir
de révélation qui veut qu’il fasse connaître aux parties les circonstances qui
sont de nature à faire douter de son indépendance ou de son impartialité17. Le nouvel AUA contrairement à la
rédaction ancienne clarifie cette obligation. Il dispose en effet que « Tout arbitre pressenti informe les parties de toute circonstance de nature à créer dans leur esprit
un doute légitime
sur son indépendance et son impartialité et ne peut accepter sa mission
qu'avec leur accord unanime et écrit ».C’est une reprise mutatis mutandis
de l’article 11 du Règlement d’arbitrage de loi type CNUDCI18.
En outre, l’arbitre doit satisfaire aux exigences de compétence, disponibilité et de diligence. D’abord, il s’avère
que le caractère technique de l'arbitrage exige que l'arbitre soit
intellectuellement capable de conduire une procédure arbitrale avec efficacité
et professionnalisme. Pour ce faire, il, doit disposer d’une expertise certaine dans la matière qui lui est soumise et être en mesure de faire preuve
de technicité dans l’exercice
de sa mission.
Ensuite,
relativement à sa disponibilité, L’alinéa 2 de l’article 4-1 du RA/CCJA dispose
que l’arbitre
« doit poursuivre sa mission jusqu'à son
terme » ce qui voudrait dire qu’il doit disposer du temps nécessaire à la
bonne exécution de sa mission. Cette exigence est d’autant importante que la
chambre de commerce internationale, à titre de comparaison, exige que l’arbitre
signe une déclaration de disponibilité avant sa nomination19.
Enfin,
l’exigence relative à la diligence prévue l’article
4-1 du règlement précité oblige l’arbitre à
« poursuivre sa mission (…) avec diligence
et célérité ». Cela suppose qu’il accorde un grand soin à sa mission dans
la mesure de ses potentialités tout en agissant avec célérité et efficacité de
sorte à ne pas laisser s’écouler les délais de l‘arbitrage jusqu’à son
extinction. Par ailleurs, tout comme un véritable juge, dans la conduite de
l’arbitrage, l’arbitre doit être garant du principe du contradictoire qui est
une exigence relevant du droit à un procès équitable. A ce titre il doit
traiter les parties avec égalité20 et leur
donner la possibilité de discuter
et d’argumenter préalablement l’énoncé des faits et des moyens de droit
qu’elles présentent avant qu’il ne rende sa sentence. L’article 14 al 3 du nouvel
AUA dispose à juste ne titre
que l’arbitre « ne peut retenir
dans sa décision
les moyens, explications ou documents invoqués
ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en
débattre contradictoirement. »
Pour finir il
parait judicieux de rappeler que l’arbitre en tant que professionnel est tout
aussi tenu de respecter le secret professionnel . Cela est de nature d’une part
à l’empêcher de révéler l’information relative à l’arbitrage dont il a
connaissance dans la mesure où toute la procédure arbitrale est
14 Art 4-1 du règlement d’arbitrage de la CCJA.
15 G. KEUTGEN, L’éthique dans l’arbitrage, Collection
sous la responsabilité de Francarbi, BRUYLANT, p.13
16 Ibid.
17
Art 4-1 al 3 du
règlement d’arbitrage de la CCJA, « Avant
sa nomination ou sa confirmation par la Cour, l'arbitre pressenti révèle par
écrit au Secrétaire Général toutes circonstances de nature à soulever des
doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance ».
18 Cette obligation est également
prévu par l’art 11 du Règlement CCI et l’article 1456 al.2 du CPC issu du
décret du 13 janvier 2011.
19 Article 11 al 2 du règlement d’arbitrage de la
Chambre de Commerce Internationale.
20
Art.9 AUA, « les parties doivent être traitées sur un
pied d’égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir
ses droits ».
confidentielle
et d’autre part l’oblige à respecter le secret du délibéré aussi bien à l’égard
des tiers qu’à l’égard des parties.
2 : Les parties et leurs conseils
Les parties
jouent un rôle non moins important dans la conduite de la procédure arbitrale
qui ne peut d’ailleurs être enclenchée que par leur volonté de soumettre leur litige à un arbitre.
Ce faisant, les parties
doivent se montrer respectueuses à la loi qu’ils ont désignée comme devant
conduire l’arbitrage auquel ils sont partis. Ils doivent agir de bonne foi. La
bonne foi des parties et de leurs conseils implique que ces derniers agissent
avec honnêteté et sincérité tout en évitant de quelque manière que ce soit
d’empêcher le bon déroulement de la procédure arbitrale ou d’empêcher
directement ou indirectement l’arbitre de mener à bien sa mission. En toute
loyauté, les parties doivent donc participer au bon déroulement de l’arbitrage
en évitant aussi bien les manœuvres frauduleuses que les manœuvres dilatoires comme
l’exige le nouvel
acte uniforme relatif
au droit d’arbitrage21. Elles ne doivent
donc pas à titre illustratif,
procéder à des récusations fantaisistes des arbitres ou à des recours non
fondés contre la sentence arbitrale dans le but de « faire marcher le compteur » ou influencer l’arbitre en le
poussant à la démission22.
De plus, à l’instar de l’arbitre, les parties et leurs conseils doivent
tout mettre en œuvre pour respecter le principe du contradictoire. C’est par le
truchement de la règlementation sur la communication des pièces que la loi ou
les règlements s’assurent que les parties respectent le principe du
contradictoire23.
Ces derniers sont non seulement tenus de se communiquer les pièces, mais aussi ils sont tenus de le faire
dans les délais raisonnable pouvant les mettre en mesure de répondre chacun aux
pièces produites par l’autre partie. Aussi, ces pièces doivent être produites
en autant d’exemplaires qu’il y a de parties24. Cette exigence est un gage de loyauté des
débats, de transparence de la procédure
et de manifestation de la vérité
qui, in fine, est le but de l’arbitrage25.Par ailleurs, étant incontestablement l’un des éléments attrayant de l’arbitrage26, les parties et leurs conseils sont
tenus au secret, tenus de respecter la confidentialité de la procédure
arbitrale. Cette exigence, pour en rajouter à ce qui a été déjà dit sur la
confidentialité des arbitres répond à une nécessité d’assurer le secret des
affaires tout en donnant aux parties l’assurance que leurs déboires, leurs stratégies secrètes, et en général
la conduite et l’état de leurs
affaires ne vont pas être exposés aux concurrents27.
Au-delà de l’arbitre, des parties et de leurs conseils,
des règles éthiques s’adressent aussi
à d’autres acteurs
ayant un lien direct ou indirect avec la procédure arbitrale.
B : L’Ethique au regard des
autres acteurs de la procédure arbitrale OHADA
Quels qu’ils
soient et à quelque titre qu’ils interviennent, les autres acteurs
de la procédure arbitrale dans la mesure où ils œuvrent tous vers
l’obtention d’une sentence arbitrale ont leur éthique propre. Ainsi, les
centres arbitrages et le juge d’appui (1) ainsi que les experts, les témoins,
et les tiers financeurs (2) ont tous une ligne de conduite à suivre pour la
bonne marche de la procédure arbitrale.
1 : les
centres d’arbitrage et le juge d’appui
Les centres ou
institutions d’arbitrage tirent leur raison d’être de la notion d’arbitrage
institutionnel qui avions nous dit est organisé par une institution ou centre
d’arbitrage conformément au Règlement
d’arbitrage de cette institution, ledit règlement fixant la procédure arbitrale
à suivre. Le cas typique de centre d’arbitrage dans la zone OHADA est celui du
centre d’arbitrage de la CCJA. Charger d’administrer les procédures arbitrales
qui se déroulent en son sein, le centre même a un devoir moral d’indépendance et d’impartialité, doit être neutre
et irréprochable et impulser une dynamique forte dans
21
Art 14 al 4 « Les parties agissent avec célérité et
loyauté dans la conduite de la procédure et s'abstiennent de toutes mesures
dilatoires. ».
22 P.O.TOMANDJI NZAPAHAM, L’éthique dans l’arbitrage international, p.125.
23 G.POUGOUE, Encyclopédie OHADA, p.270.
24 Art.12-1 du RA/CCJA : « Les mémoires et toutes communications
écrites présentés par toute partie, ainsi que toutes pièces annexes, sont fournis en autant d'exemplaires qu'il y a de parties
plus un pour chaque arbitre
et une copie électronique est
envoyée au Secrétaire Général ».
25 P.O. TOMANDJI NZAPAHAM,
op.cit., p.126.
26G. POUGUOE op. Cit. p.274.
27 Ibid. p.275.
l’instance
arbitrale28. Il a l’obligation de faire
respecter le règlement et la loi régissant la procédure arbitrale29 et s’assurer des qualités des potentiels
arbitres, notamment leur indépendance, impartialité et disponibilité pour ne
citer que ceux-là. Le centre doit veiller aussi à ce que soient évités les
comportements dilatoires des parties et de leurs conseils. Aussi le centre
se doit d’être neutre et objectif
dans l’exercice du contrôle qu’il est appelé à exercer sur le projet de
sentences arbitrales et éviter toute immixtion dans la mission confiée au
tribunal arbitral.
Le juge d’appui quant à lui est désigné dans l’AUA par l’expression « juge compétent dans l’Etat partie ». Il
peut être saisi aussi bien avant ou après le démarrage de l’instance arbitrale30. Il doit fournir son assistance à la
procédure arbitrale à chaque fois qu’il est sollicité soit pour l’octroi des
mesures provisoires ou conservatoires31 ,
soit pour compléter le nombre d’arbitre devant constituer le tribunal arbitral
ou encore pour désigner un arbitre en lieux et place d’une partie défaillante.
Il doit le faire dans le respect de l’égalité des parties. Il joue aussi un
rôle capital nous y reviendrons dans l’exequatur des sentences arbitrales.
2 : les
experts, témoins et les tiers financeurs
La tâche de
l’expert est purement technique, n’a aucun caractère juridique et consiste en
une simple constatation technique. Sa mission est d’éclairer l’arbitre ainsi
que les différentes parties sur des questions qui relèvent de sa compétence et
il devra le faire avec diligence et bonne foi, laissant transparaitre dans les
conclusions de ses travaux, des explications objectives précises, claires,
motivées et intelligibles de façon à éclairer parfaitement la religion des
parties. Pour ce faire il se doit de faire usage d’un langage simple
correspondant au niveau de compréhension des parties. Si d’aventure il est
contredit dans ses travaux par d’autres experts, il devra répondre en toute
courtoisie.
Les témoins,
eux, doivent respecter les règles relatives au témoignage et doivent dire la
vérité et rien que la vérité.
Quant aux tiers
financeurs, leurs existence liée à l’opération de tiers financement doit être
révélée par les parties. Le tiers financement est un « mécanisme de financement
du contentieux par un tiers, qui prend à sa charge tous les frais du litigant
relatifs au procès, en échange de quoi il récupère un pourcentage sur les
dommages et intérêts gagnés à l'issue du procès »32.
Ces tiers doivent éviter d’intervenir dans le choix ou le remplacement des arbitres
et éviter en cours de procédure arbitrale de mettre les arbitres en situation
de conflit d’intérêt .L’éthique est pourtant une exigence à efficacité mitigée
II : L’ETHIQUE, UNE EXIGENCE A L’EFFICACITE MITIGEE
Au regard des
développements précédents, l’on constate que l’éthique constitue une clé de
voûte de la procédure arbitrale OHADA. Afin d’asseoir cette efficacité et pour
une meilleure effectivité des règles éthiques dans la zone OHADA, la CCJA et
les juges des Etats-parties font office d’acteurs ultimes de contrôle du respect des règles éthiques
(B). Pourtant avouons-le, la problématique de la force normative
incertaine des règles éthiques tempère leurs efficacités (A).
A : La problématique de la force
normative des règles éthiques
Parler de la
force normative des règles éthiques dans l’arbitrage OHADA, c’est déterminer
leur valeur juridique et leur portée dans le rapport d’inter normativité avec
le droit positif arbitral en vigueur dans l’espace OHADA. Les règles éthiques
et le droit de l’arbitrage sont deux normes de conduite sociale distinctes avec
des valeurs normatives différentes. Le droit de l’arbitrage est une norme
juridique. Les règles éthiques, par contre, sont des règles extra juridiques.
Malgré l’incertitude de la juridicité des
28 P.O. TOMANDJI NZAPAHAM, op.cit. p.127.
29 Charte éthique de la fédération des centres
d’arbitrages, p.4.
30Joseph BELIBI et Gaston KENFACK DOUAJNI, Revue
ERSUMA, numéro spécial 2011, p.52.
31 Ibid.
32 J.R. COSTARGENT, Le financement par
un tiers comme réponse aux évolutions de l’arbitrage international, article
Parrainé par Guy Lepage, Directeur Général de La Française AM International
Claims Collection.
règles éthiques
(1), elles font bon ménage
avec le droit de l’arbitrage en rendant plus attractif l’arbitrage dans la sphère OHADA (2).
1
: L’incertitude de la juridicité des règles éthiques
La juridicisation de l'éthique signifie
la reconnaissance ou la réception
par l'ordre juridique étatique des principes
éthiques ou déontologiques33.
Cette juridicité paraît affaiblie en raison de la faible effectivité de ces
principes. Celle-ci trouve en réalité son explication dans deux facteurs : la
reprise des principes de l'éthique par les règles
de droit et la dépendance de l’éthique au droit positif34. L’éthique poursuit
un but, celui de déterminer les valeurs auxquelles les comportements
doivent correspondre pour être jugés socialement bons, c’est-à-dire permettre
une vie sociale harmonieuse35.
Les règles juridiques visent à protéger, fluidifier, pacifier les rapports au
sein de la société et à régler les conflits. En ce sens ne sont- elles pas une
morale ou à tout le moins ne prennent-elles pas une dimension ou coloration
éthique ? Certes le droit peut s’approprier des pans d’éthique parmi ceux qui
font consensus dans la société mais il ne saurait être une morale et pas
davantage une éthique bien attendue. Il existe une différence importante entre
les règles juridiques et les règles éthiques rendant in fine incertaine la juridicité de ces dernières. La différence fondamentale entre ces deux systèmes normatifs semble se situer
à trois niveaux majeurs : leurs forces
normatives, leurs sources et leurs objets36 .
D’abord, la
règle de droit est une émanation de la puissance publique. Elle est dotée d’une
force obligatoire et est assortie de sanction en cas d’inobservation. Comme le
fait constater le Prof. Ch. JARROSSON « la
différence entre les deux systèmes normatifs est que le droit contraint et pas
la morale qui est étymologiquement synonyme de l’éthique »37. La
règle juridique est hétéronome. La violation d’une règle éthique n’entraine pas
une action en justice, mais elle donne lieu plutôt à des mesures disciplinaires
internes, organisées par les parties prenantes. Aussi, les règles éthiques ne
sont pas opposables aux tiers qui ne sont pas parties prenantes et aucune
poursuite judiciaire ne peut être diligentée à leur encontre sur la base de
celles-ci. La règle éthique, est extra juridique, d’essence privée et correspond à une norme
autonome qui a pour but de réguler
en interne les comportements d’un groupe
d’individus déterminés et n’aurait de sanction que dans la voix de la
conscience Il s’agit d’une norme d’autorégulation et d’autocontrôle.
Ensuite, l’éthique contrairement à la règle juridique a un objet limité
à une situation déterminée. Elle se préoccupe d’une matière ou d’une activité
spécifique. Appliquée à l’arbitrage par exemple l’on pourrait dire comme le pense
Mr. Jalal El AHDAD que « l’éthique
arbitrale regroupe un ensemble de valeurs et de comportements que les
différents protagonistes d’une procédure devraient respecter (ou faire
respecter) pour préserver l’arbitrage de ses abus »38. L’éthique semble donc
avoir une vertu sectorielle. Il s’agit ici d’une éthique arbitrale dans la
sphère OHADA ou encore de l’éthique dans l’arbitrage OHADA. C’est tout comme la biologie, ou encore la médecine qui disposeraient par exemple
d’une « bioéthique ». La règle de droit
par contre, a un objet qui couvre un champ d’application plus large. Elle est
dotée d’un caractère général. A cet effet, les prescriptions de la règle de
droit ont pour vocation d’assainir, d’harmoniser la vie en société et de
réguler les comportements collectifs en vue d’une organisation sociale paisible39. Le droit renvoie
à la régulation des comportements par la loi alors
que l’éthique renvoie plus largement à la distinction entre le bien et le mal,
à ce qu’il convient de faire indépendamment ou au-delà de nos obligations
strictement légales.
33 Cf. A.
JEAMMAUD, « Introduction à la sémantique de la régulation juridique », in Les
transformations de la régulation juridique, L.G.D.J., 1998. Le terme
juridicisation peut être utilisé pour désigner « une évolution du rapport entre le droit et les relations sociales,
soit par extension
de l'empire du premier, soit par densification de la couverture
qu'il impose aux secondes ».
34 P.NGUIHE KANTE « A propos de l’effectivité des codes
d’éthique : contribution à un changement de perspectives des sources créatrices
du droit privé » Revue de l’ERSUMA, n° 2 de Mars 2013, p.11.
35 Cf
Pr. Ch. JARROSSON op.cit.
36 P.O.TOMANDJI NZAPAHAM
op.cit., p.172 et svtes.
37 Rapport
du Colloque Francarbi précité
38 Jalal El AHDAD « l’éthique dans la conduite et la gestion de
l’arbitrage ».
39 C.LAVALLEE
« A la frontière de l’éthique et du droit », article 1993.24 RDUS p.15.
Enfin, la règle
de droit puise sa source dans la législation étatique. C’est une émanation de
la puissance publique. Le droit se conçoit à partir d’un ensemble de règles
édictées par une autorité légitimée. Les règles juridiques proviennent des
sources directes40 ou indirectes41. La règle éthique par contre est édictée, non
pas par un législateur, mais plutôt par un groupe privé de personnes et elle a
pour but de réguler en interne les comportements de ce groupe de personnes.
L’éthique dans ce cas est autonome et
non juridicisée. Malgré cette distinction entre les règles éthiques et les
règles juridiques, il existe entre elles une grande complémentarité. Le droit
se tourne fréquemment vers l’éthique et l’éthique vers le droit.
2
: L’heureuse coexistence des règles éthiques aux cotés des règles du droit
positif
La règle de
droit en général et le droit de l’arbitrage OHADA en particulier se teintent de
plus en plus de règles éthiques. L’éthique est une source d’inspiration de la
règle de droit (a) et cette dernière est un gage d’efficacité et d’effectivité
des règles éthiques dans la sphère arbitrale (b).
a : L’éthique, source
d’inspiration du législateur arbitral OHADA
L’élaboration
des règles éthiques dans l’arbitrage contribue non seulement à renforcer le
droit positif en vigueur mais aussi à inspirer le législateur arbitral. En effet, même si le droit dispose
d’une autonomie propre par
rapport à la morale, « le droit ne
grandit en légitimité que s’il est conforme à celle-ci ».42 Selon une vue optimiste et réaliste du Prof P.
DIENER, « le droit, tout le droit, même
dans ses aspects les plus techniques, est toujours dominé
par la loi morale dans sa fonction
normative ».43 Le législateur arbitral peut s’inspirer des règles éthiques
élaborées par les opérateurs de l’arbitrage, car ces règles
sont l’expression de leur volonté commune.
Bien plus les règles éthiques
reflètent la réalité
et tiennent compte d’un certain nombre de
problématiques pratiques de l’arbitrage. Ainsi, pour rendre plus efficace et
effectif le droit de l’arbitrage, le législateur doit tenir compte de ces
règles éthiques issues de la régulation autonome .En ce sens, nous pouvons
faire constater que le nouvel
AUA ainsi que le nouveau RA/CCJA reprennent dans leurs
quasi-totalités les obligations ou exigences éthiques des différents acteurs de la procédure
arbitrale OHADA. D’autres
exigences éthiques ont été clarifiées. Il s’agit à titre
d’exemple de l’obligation de révélation qui pèse sur l’arbitre en droit OHADA
au sens du nouvel article 7 al.3 de l’AUA. L’exigence
éthique de disponibilité qui pèse sur l’arbitre apparait finalement dans le
RA/CCJA. Parfois, l’éthique préexiste à la règle juridique. Beaucoup d’auteurs,
rappel le Prof Ch. JARROSSON « ont établi
que beaucoup de règles juridiques ont été longtemps avant des règles éthiques ».
Lorsque la nécessité du recours à l’éthique se manifeste, « c’est le signe que le droit est insuffisant, que les règles
ont failli. Le recours à l’éthique naît spontanément de la volonté
de rendre un milieu plus vertueux »44.La
règle juridique est une arme importante de valorisation des règles éthiques.
b
: La règle de droit, gage d’efficacité et d’effectivité des règles éthiques
Le droit se tourne fréquemment vers l’éthique et l’éthique vers le droit.
Le droit de l’arbitrage ne doit pas aller à l’encontre des normes éthiques. Il
doit plutôt s’en nourrir pour une réglementation efficace. Lorsque la règle de
droit s’incorpore des règles éthiques, ces dernières deviennent efficaces et
rendent le droit de l’arbitrage effectif. Les règles juridiques mettent au
service des règles éthiques la force contraignante et rendent ainsi vertueux la
sphère arbitrale. Que les principes posés par l'éthique soient ou non une
reprise de règles de droit existantes, il faut reconnaître qu'ils peuvent
parfois acquérir une force obligatoire. Dans ce cas, cette reconnaissance
résulte du droit. Cette valeur juridique va de soi lorsque le principe éthique
s'incarne dans une règle de droit existante. Mais le droit peut aussi conférer
indirectement dans certaines conditions des effets juridiques à l'éthique. Parler de la prise
en considération de l’éthique par le droit de l’arbitrage OHADA revient donc à
savoir entre autres comme
40 Les sources directes sont les
textes officiels, eux même répertoriées selon une stricte hiérarchie. La
constitution, les traités internationaux d’abord, puis les lois, puis les
règlements, les ordonnances et les arrêtés.
41 Elles sont représentées par la jurisprudence, la
doctrine et la coutume.
42 N. DELEUZE,
A.B. MIRKOVIC, Introduction générale au
droit, le droit objectif les droits subjectifs l’action en justice,
panorama du droit, collection dirigée par Guillaume Bernard, p. 59.
43 Cf. P. DIENER, Ethique et droit des affaires, Rec.
Dalloz Sirey, 1993, chr. p. 17, n° 2; et dans le même sens,
G.RIPERT, La règle morale dans les obligations civiles, 4e éd., LGDJ, 1949, n°s 13-18
; J. T. DELOS, Le problème
des rapports du droit et de la morale, Arch. Phil. Droit, 1933, p.p. 84 à 111
44 Ch.JARROSSON, propos dans
colloque précité.
le pense
Mr. KENFACK si « les exigences d’indépendance, d’impartialité et de disponibilité qui pèsent sur les
arbitres sont connues du droit de l’OHADA. La réponse selon lui « est affirmative tant sur le plan des
principes que de la pratique.»45 et nous la
partageons .En effet, l’ancien 46AUA OHADA tout comme le nouveau, exigent des
arbitres qu’ils soient indépendants, impartiaux et disponibles. L’alinéa 3 du
nouvel AUA dispose à cet effet que «
l’arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils et demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties ».Le
nouveau RA/CCJA exige aussi des arbitres
qu’ils soient indépendants et impartiaux. 47« Tout arbitre
nommé ou confirmé par la Cour doit être et demeuré indépendant et impartial
vis-à-vis des parties ».C’est ce qui
résulte expressément des dispositions de l’art.4.1 dudit Règlement. L’exigence de disponibilité se retrouve aussi dans l’article
4.1 du même Règlement. On voit très bien que ces trois exigences
éthiques importantes sont connues du droit de l’arbitrage OHADA. Cette prise en considération de l’éthique par le droit rend efficace
l’éthique dans l’arbitrage OHADA.
B : Le contrôle du respect des
règles éthiques dans la zone OHADA
Outre les arbitres et les parties
qui sont les acteurs principaux de la procédure
arbitrale, il existe
d’autres acteurs qui s’assignent pour mission de contrôler le respect
des règles éthiques. Rappelons que ces acteurs subsidiaires sont eux même
soumis au mécanisme de contrôle .C’est ce qu’on l’on appelle l’autocontrôle. Il importe donc de relever
non seulement les acteurs de contrôle (1) du respect
des règles éthiques en droit
OHADA mais aussi les mécanismes du contrôle
(2).
1 : Les acteurs du contrôle
Il s’agit en
droit OHADA de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage qui fait office de
Centre d’arbitrage (1) et du juge étatique (2) qui fait office de juge d’appui
garant de la justice arbitrale.
a-la CCJA, une institution clé du contrôle et d’autocontrôle
La CCJA est le
centre d’arbitrage dans la zone OHADA. Elle veuille non seulement au respect
par les acteurs de la procédure arbitrale des différentes obligations
juridiques et éthiques envisagées précédemment. Elle s’efforce de vérifier la compétence et la disponibilité des arbitres qu’ils
sont appelés à désigner ou à
confirmer. Elles veillent aussi à la constitution d’un tribunal indépendant et
impartial et vérifient ces différents aspects sur la base de déclarations que
remplissent les arbitres après leur désignation.
D’abord, la
CCJA contrôle lorsqu’il lui est demandé, la conformité des sentences arbitrales
aux règles éthiques. A titre
d’exemple citons la récente décision rendue en date du 29 juin 2017 par la
deuxième chambre de la CCJA48. Après un
pourvoi en cassation diligenté contre une décision de la cour d’appel de Douala
ayant annulé une sentence arbitrale pour violation par l’arbitre de son obligation de révélation, la
CCJA répond qu’ « il est de jurisprudence
que l’arbitre doit révéler toute circonstance de nature a affecté son jugement
et à provoquer dans l’esprit des parties un doute raisonnable sur ses qualités
d’impartialité et d’indépendance qui sont de l’essence même de la fonction arbitrale
».Elle s’est bornée à conclure qu’ « en s’abstenant de se prononcer sur l’allégation d’absence
d’impartialité soulevée par le demandeur, l’arbitre a commis un dol procédural
de nature à remettre en cause non seulement son indépendance, mais aussi la
sentence arbitrale à venir..». Il s’agit bien ici du contrôle de la
régularité d’une sentence arbitrale au regard de l’obligation éthique de
révélation qui pèse sur l’arbitre qui bien attendu est l’acteur principale de
la conduite du processus arbitrale. Même si cette décision de la CCJA a été
qualifiée de « regrettable » par une
partie de la doctrine africaine49 qui estime
que le manquement par l’arbitre de son de révélation ne devrait pas entrainer
per se l’annulation de la sentence arbitrale.
Il
45
G.KENFACK
DOUAJNI « l’éthique des centres d’arbitrage, exemple de l’OHADA » acte du
colloque international du 09 décembre 2011 organisé par Francarbi portant sur «
l’éthique dans l’arbitrage ».
46 AUA du 11 mars 1999 voir l’art.6 alinéa 2.
47Rappelons qu’il s’agit d’une évolution. L’art 4.1 de l’ancien règlement faisait peser sur l’arbitre que l’obligation
d’indépendance. «
Tout arbitre nommé ou confirmé par
la Cour doit être et demeurer indépendant des parties en cause ».
48 Recueil de jurisprudences de la CCJA, arrêt n°
151/2017 du 29 juin 2017
49 Prof.B.KAMENA « l’indépendance et
l’impartialité de l’arbitre : la position regrettable de la CCJA » dans
Lamilyne, rubrique « Droit africain » ;Wolters kluwer, www.actualitesdudroit.fr du 09
novembre 2017.
faut quand même
apprécier cette volonté de la CCJA de garantir le respect des exigences
éthiques dans l’arbitrage OHADA.
Ensuite,
l’observation des règles éthiques dans l’arbitrage de la CCJA se manifeste de
deux manières : la non-participation du personnel de la CCJA à l’arbitrage CCJA
et l’autonomisation de la fonction d’administration de l’arbitrage à la CCJA.
Concernant la non-participation du personnel de la CCJA, indiquons que ni le
Président de la Cour, ni les juges de la Cour, ni le Secrétaire général de la
Cour ne peuvent être nommés arbitre car le Règlement d’arbitrage de la Cour le
leur interdit. De même, si ces derniers sont intéressés à quelque titre que ce
soit par une procédure arbitrale pendante au centre d’administration d’arbitrage de la Cour, ils ne reçoivent pas la documentation relative à la dite procédure et doivent même être absents de
la session de la Cour au moment de l’examen de l’affaire. Concernant
l’autonomisation du centre d’administration de l’arbitrage de la CCJA, le
mélange de genre qui était redouté au sujet du risque de confusion de la
fonction juridictionnelle de la Cour et de l’autonomie du centre d’arbitrage ne s’est jamais
réalisé car la Cour a su faire la part des choses entre les deux fonctions.
Enfin, une autre
manifestation de la garantie de l’éthique dans l’arbitrage CCJA réside dans la
création par le traité institutif de l’OHADA révisé le 17 Octobre 2008 au
Québec d’un poste de secrétariat autonome chargé de l’administration des arbitrages.
Jusque-là, cette fonction relevait des attributions du greffier en chef de la
CCJA. Cette réforme permet bien évidement selon M .G.KENFACK relayé par
A.S.MAFONGO KAMGA « d’éloigner de la CCJA
le spectre du mélange de genre que l’on redoutait et présentait comme
une menace contre
l’expansion de l’arbitrage de l’OHADA »50.Les juges des Etats-parties jouent aussi rôle
non négligeable.
b- le juge étatique, un acteur ultime du contrôle juridictionnel de
l’éthique en droit OHADA
Ayant perçu la complémentarité
entre la justice étatique et celle arbitrale, le législateur communautaire
OHADA à travers l’AUA ancien comme le nouveau, clarifie le rôle du juge
étatique comme pouvant intervenir dans la constitution du tribunal arbitral en
tant que juge d’appui. Il intervient également comme juge du contrôle de la
régularité en tant que juge garant de la qualité de la justice arbitrale. Le
juge étatique est donc juge du contrôle de la régularité des sentences
arbitrales aux règles éthiques .Il exerce cette mission
lorsqu’une sentence arbitrale a fait l’objet
d’un recours devant
lui (1) ou encore au moment de l’exequatur d’une sentence
arbitrale (2).
b1-Le recours en droit OHADA
contre la sentence arbitrale devant le juge étatique
La sentence
arbitrale en droit OHADA est soumise à un régime spécifique des voies de
recours. Conformément aux dispositions de l’art.25 du nouvel AUA, sont ouvertes
contre la sentence arbitrale, les recours en annulation et en révision de même
que la tierce opposition. Par contre son exclus, les voies d’appel, le pourvoi
en cassation et l’opposition. C’est une particularité du système arbitral OHADA dans la mesure
où le droit français autorise
l’appel contre une sentence arbitrale. L’interdiction de l’appel en droit OHADA se justifie
bien. D’abord, il est paradoxal soutien Madame S.M.KAMGA
51 de soumettre au juge étatique par
voie d’appel la sentence rendue par un tribunal arbitral désigné précisément
pour écarter le juge étatique. Ensuite en matière international, le juge
étatique du siège de l’arbitrage ou du lieu d’exécution de la sentence n’aura
le plus souvent aucun lien avec le litige donc aucune compétence internationale
pour statuer.
Contrairement au recours
en révision qui est porté
devant le tribunal
arbitral, le recours
en annulation et la tierce opposition sont portés
devant la juridiction compétente de l’Etat partie. On retrouve ici une
innovation dans la mesure où le recours
en annulation était le seul autorisé devant le juge étatique52.
50 A.S.MAFONGO
KAMGA « l’éthique dans l’arbitrage OHADA : Etude à la lumière de la pratique
internationale », Revue Trimestrielle de
Droit Africain, n° 894, éd.,Pénant, janvier-Mars 2016 p.85. Voir aussi
Gaston KENFACK « l’éthique des centres d’arbitrage exemple de l’OHADA » dans
acte du colloque précité.
51 Art précité.
52 L’article
25 al.4 de l’AUA de 1999 dispose à cet effet que « la sentence arbitrale peut faire l'objet d'une tierce opposition
devant le tribunal arbitral par toute personne physique ou morale qui n'a pas
été appelée et lorsque cette sentence préjudicie à ses droits ».
Aujourd’hui,
l’alinéa 5 de l’art.25 de l’AUA de 2017 prévoit expressément que « la sentence arbitrale peut faire l’objet
d’une tierce opposition par toute personne devant la juridiction de l’Etat
partie qui eut été compétente à défaut d’arbitrage et lorsque cette sentence préjudicie ses droits ». Le juge étatique
devant lequel la tierce opposition ou le recours en annulation seront portés,
sera la Cour d’appel (CA) des Etats membres puisque la décision du juge
compétent de l’Etat partie n’est susceptible que de pourvoi en cassation que devant la CCJA. L’art.
26 de nouvel AUA de même que l’art. 29.2 du nouveau R/CCJA prévoient une liste limitative
des griefs permettant d’annuler la sentence arbitrale par le juge étatique. Il
s’agit des hypothèses suivantes : l’incompétence du tribunal ou sa compétence
déclarée à tort, un tribunal arbitral irrégulièrement constitué ou de l’arbitre
unique irrégulièrement désignée, l’arbitre a statué sans se conformer à la
mission qui lui avait été confiée, le non-respect du principe du contradictoire
et enfin de l’hypothèse d’une sentence arbitrale contraire à l’ordre public ou
encore une sentence dépourvue de motivation. La CA de Douala au Cameroun dans
une décision en date du 19 décembre 2014 53
et faisant office de juge étatique, a annulé une sentence arbitrale
rendue en méconnaissance des règles
éthiques qui transcendent les dispositions de l’article 7 de l’ancien
AUA. Par contre si le juge
étatique vide sa saisine il déclare le recours en annulation non fondé, la
sentence peut être exequaturée.
b-2-L’exequatur des sentences
arbitrales par le juge de l’Etat-partie au traité OHADA
La sentence
arbitrale n’a pas de plein droit une force exécutoire. Telle est la conséquence
de la nature privée de la justice arbitrale. Tout comme dans les autres
systèmes, la sentence arbitrale en droit OHADA n’est susceptible d’exécution
forcée qu’en vertu d’une décision d’exequatur rendue par la juridiction
compétente dans l’Etat partie. Ceci résulte expressément des dispositions de
l’art.30 du nouvel AUA. Il revient donc au juge étatique après
demande des parties
de rendre exécutoire la sentence
arbitrale par voie d’ordonnance. Cependant, si la sentence est manifestement
contraire à une règle d’ordre public international des Etats-parties, le juge
étatique peut refuser l’exéquatur. Contrairement à la décision accueillant
l’exéquatur qui n’est susceptible d’aucun recours54,
celle qui refuse l’exéquatur est susceptible conformément au second alinéa de
l’art 32 du nouvel AUA de pourvoi en cassation devant la CCJA. Le rejet du
recours en annulation dans l’arbitrage ad hoc OHADA emporte, de plein droit,
validité de la sentence arbitrale ainsi que de la décision ayant accordé
l’exequatur55.En ce qui concerne
l’exequatur des sentences arbitrales rendues en dehors de l’espace OHADA,
l’article 34 du nouvel AUA prévoit que «
les sentences arbitrales rendues sur le fondement des règles différentes de
celles prévues par le présent Acte uniforme sont reconnues dans les Etats
parties, dans les conditions prévues par les conventions internationales
éventuellement applicables et, à défaut, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues
par les dispositions du présent
Acte Uniforme ».Il
faut cependant exclure de ces
sentences celles qui sont rendues dans le cadre d’un arbitrage CCJA qui, elles,
sont soumises à des règles particulières pour leur reconnaissance et leur
exequatur56.On voit très bien que la CCJA et le
juge étatique sont des acteurs ultimes dans le processus arbitral OHADA. Ils assurent à cet effet le contrôle
de la régularité des sentences arbitrales aux règles juridiques et éthiques. Ce
contrôle s’effectue à travers des mécanismes qu’il ne faut pas ignorer.
2 : Les mécanismes du contrôle
En cas de
violations des obligations éthiques contenues ou pas dans les chartes éthiques
(b), les acteurs du contrôle peuvent prononcer des sanctions (a).
a-Des
sanctions possibles
Le contrôle des règles éthiques en matière de l’arbitrage porte sur la
vérification du respect par les acteurs du processus arbitral des règles de
droit en matière arbitrale en général et des règles éthiques édictées en
particuliers. Au 1er rang
des mécanismes de contrôle on note les mesures d’autodiscipline
53 Cahier de l’arbitrage du 01
nov.2015, n° 3 p.572, décision commentée par Achille NGWANZAN.
54 Art.32 al.1 du nouvel AUA.
55 Art.33 du nouvel AUA.
56 Cf. art.30 et suiv.RA/CCJA.Pour plus de développement sur l’exequatur CCJA voir A.MOULOUL « l’arbitrage dans
l’espace OHADA » Rapport de la Conférence Internationale sur le Droit des
affaires de l’OHADA, 28 janv.2010, p.27 et suiv.
qui permettent
de dissuader et de sanctionner les acteurs de l’arbitrage qui ont manqué de
respecter les règles éthiques en commettant ainsi une faute dans leur fonction.
Les mesures d’autodiscipline jouent aussi un rôle d’intimidation collective des acteurs arbitrale
qui seraient tentés de commettre
une faute et d’enfreindre les règles qui gouvernent
le spectre arbitrale. Les mesures d’autodiscipline sont donc des moyens de
dissuasion et de sanction. L’avertissement, la suspension, la révocation sont
les sanctions disciplinaires généralement prises.
Cependant il ne faut pas croire que les règles
éthiques, parce qu’elles ne sont pas juridiques stricto sensu, seraient
per se dépourvues de toute sanction juridique57. Se focalisant
à tire d’exemple sur l’arbitre, acteur principal du processus arbitral,
Mr A.Jalel Ahdab fait constater
que
« la violation par un arbitre de l’un de ses
devoirs peut entrainer des conséquences juridiques, selon l’objet et la gravité
du manquement dont il est question » : si l’annulation de la sentence
n’apparaît aujourd’hui pas la sanction la plus naturelle, il existe une panoplie de solutions, plus ou moins
éprouvées, et qui ne laisseraient pas sous silence
ou sans conséquence le non-respect par l’arbitre d’un cadre éthique de l’arbitrage, telles que la
récusation, la réduction ou le non-versement des honoraires, la mise en jeu de
sa responsabilité personnelle civile ou pénale dans les cas les plus extrêmes,
et, sanction sans doute ultime et terriblement efficace, la non-désignation de
l’arbitre dans des arbitrages ultérieurs. Ces mécanisme de contrôle ne sont en pratique
efficace que si elles sont contenues dans une charte ou un code d’éthique.
b - Une Charte éthique dans
l’arbitrage OHADA de demain ? Pourquoi pas !
Les chartes
éthiques, les codes éthiques ou encore les codes de conduite constituent de
véritables instruments de compilation et de cristallisation des règles éthiques
régissant une matière donnée. Le constat aujourd’hui est l’émergence des codes
éthiques dans le secteur privé. Comme le relève le Prof. J-L BERGER, la
règle juridique « peut s’approprier des
règles qui lui sont à l’origine étrangères et intégrer dans le système
juridique des valeurs sociales ou éthiques sous forme de normes qualitatives et
de concepts flexibles, soumis à l’appréciation de ses destinataires, sous le
contrôle de l’interprète et du juge » 58
.Perçus dans cette optique, les codes d’éthique cessent d’être envisagés
comme certaines compilations de promesses ne liant que ceux qui y croient59.Les engagements souscrits dans ce cadre pourront être pris en compte pour
dissuader ou sanctionner les acteurs qui s’y
soumettent »Ils sont en matière arbitrale, destinés à faciliter le bon
déroulement du processus pour aboutir à la sentence finale. De ce fait chacun
les acteurs doivent pouvoir y trouver ce qui constitue les valeurs communes de
la partition qu’ils doivent jouer non pas seul mais dans un orchestre, ce qui
leurs permettra de faire face aux situations rencontrées pour la construction
commune de la sentence. En matière arbitrale, la plus part des centres
d’arbitrage sont dotés des chartes ou codes éthiques pour assurer une meilleur
efficacité du droit de l’arbitrage dont ils sont promoteurs. Tel est le cas de
la Fédération des Centres d’Arbitrage française 60
qui s’est dotée d’une charte d’éthique s’adressant à « toute personne ou institution concourant à la procédure arbitrale tels que les arbitres,
les parties, leurs conseils, les secrétaires
administratifs, les témoins, les experts, les centres d’arbitrage, les
autorités de désignation, ou encore les tiers financeurs, sans que cette liste
soit limitative »61.S’il existe sans doute une éthique dans
l’arbitrage dualiste OHADA, il n’existe pourtant pas encore un code ou une
éthique regroupant ces règles utiles à l’arbitrage. Les praticiens de
l’arbitrage OHADA doivent œuvrer en ce sens et pourquoi ne pas s’inspirer du
modèle des autres centres d’arbitrages. L’adoption de ce code qui constituera
une ligne de directive « éthique » à
suivre par tous les acteurs de l’arbitrage, facilitera non le bon déroulement
de l’arbitrage OHADA mais aussi constituera un stimulant important pour son
d’attractivité.
57 Jalel El Ahdab, dans acte de
colloqué précité
58
Prof J-L BERGEL
in Droit et déontologies professionnelles,
1997, Libr. Univ. Aix-en-Provence, p. 16.
59 On peut rencontrer des chartes ou
codes d’éthique participant formellement de la logique sous-entendue par un
engagement susceptible d’être
intégré dans le droit, mais ne reproduisant en réalité qu’un « discours
creux à portée publicitaire » (G. FARJAT, « Réflexion sur les codes de conduite
privé », in Études offertes
à Berthold Goldman, Le droit des relations
économiques internationales, Litec, Paris, 1982, p.47-66 préc, p. 65)
60 La FFCA regroupe aujourd’hui
15 Centres d’arbitrage français. Voir plus sur le site de la fédération.
61 On retrouve cette vision dans les propos introductifs de la Charte.
Conclusion
A la lecture
des lignes ci-dessus, deux remarques peuvent rapidement être faites. D’abord le
secteur arbitral est menacé par les dérives de ses acteurs. Ensuite, le
panjurisme arbitrale compris comme la volonté de résoudre tous les problèmes de
l’arbitrage par les normes juridiques est tenu en échec. De ce constat, le
recours à l’éthique est devenu une nécessité incontournable. L’éthique dans l’arbitrage
correspond à des règles de conduites morales
objectives, issues de la pratique
arbitrale ou de la morale elle-même, visant, d’une part, à rappeler
aux opérateurs de l’ arbitrage
les principes fondamentaux qui encadrent leurs activités et, d’autre part, à compléter le
droit positif en vigueur pour lutter contre les dérives actuelles. Elle est
bien présente dans l’arsenal juridique arbitral OHADA. Elle est présente tant
dans l’arbitrage ad hoc OHADA que dans l’arbitrage institutionnel confié à la
CCJA. L’efficacité et l’effectivité des règles éthiques de la Zone OHADA ont
été renforcées par l’adoption d’un nouvel AUA et d’un nouveau RA/CCJA. Elles
n’attendent donc que leur cristallisation au sein d’un code ou d'une charte éthique.
Par
Komlanvi AGBAM,
Master 2 droit des affaires internationales, Université de Dijon Hodabalo
Bidjaréou MOUZOU, Master 2 Justice et droit du procès, Université de Kara

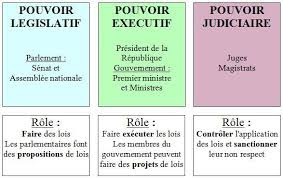


Commentaires
Enregistrer un commentaire