le Conseil d'Etat: des origines à nos jours
INTRODUCTION
Dans
sa fonction consultative le CE est chargé de conseiller le gouvernement depuis
les temps anciens, et s’occupe aussi du parlement depuis les récentes années.
Sa fonction contentieuse se caractérise par la connaissance des pourvois formés
contre les arrêts rendu par les cours Administratif d’Appel, l’examination
desdits arrêts en vérifiant le respect par les autres juridictions
administrative les règles applicable dans la procédure. Il est aussi chargé de
statuer en premier et dernier ressort sur certains litiges qui lui sont
directement soumis.
Dans
tout pays, la constitution est la source essentielle de tout le droit et donc
du droit administratif dont le CE en assume la responsabilité. C’est elle qui
organise le système de légalité et c’est par rapport à elle que s’interprète la
place respective des différentes sources de la légalité d’où la formule
éclairante du doyen Vedel qui parle « des bases constitutionnelles du
droit administratif ». Bien que tardivement, le contrôle de
constitutionnalité a été introduit en 1958 sous une institution spécialisée
qu’est le Conseil Constitutionnel. Ainsi, l’existence d’un juge Constitutionnel
est un acquis récent.
Ces
deux institutions ont différent domaine d’actions.
D’une
part le CE est chargé du contrôle de légalité et d’autre part le Conseil Constitutionnel
de l’exécution d’un contrôle de constitutionnalité des lois. Le CE comme le
conseil constitutionnel est bien « une juridiction spécialisée, juge
d’attribution, souverain dans l’exercice de sa compétence mais non une cour
suprême polyvalente » comme le soulignait Vedel dans ‘’ la légitimité de
la jurisprudence’’.
Ainsi
‘’le CE, juge constitutionnel’’ comme sujet soumis à notre réflexion s’inscrit
parfaitement dans cette logique.
En
effet, la saisine du Conseil Constitutionnel au tout début n’était ouverte que
pour quatre autorités à savoir le Président de la République, les présidents
des deux assemblées (Assemblée Nationale et le Senat) et le Premier Ministre.
L’évolution fut d’abord marquée par la réforme du 29 Octobre 1974 qui autorisa
60 parlementaires à saisir le Conseil Constitutionnel et enfin de la réforme du
23 Juillet 2008 qui mis en place la question prioritaire de constitutionnalité
qui est un droit reconnu à toute personne qui est partie à un procès ou une
instance de soutenir qu’une disposition législative porte atteinte aux droits
et libertés que la constitution garantie.
Avec
cette dernière réforme, le CE dans ses fonctions s’est vu confronté à des
litiges impliquant une ou plusieurs normes constitutionnelles et aussi à
l’élargissement de sa fonction consultative au parlement. Quelques ambiguïtés
viennent à l’esprit, celles de savoir les réelles fonctions du CE ; et
s’il peut intervenir dans la constitutionnalité. Bref la véritable question est
de savoir si dans l’exercice de ses fonctions le CE peut intervenir dans la
constitutionnalité des lois.
Ces
problèmes ont suscité des points de vue différents tant de la part du conseil
constitutionnel, du CE lui-même que de la part de la doctrine surtout à propos
de sa fonction contentieuse.
Le
CE pour sa part n’a pas attendu 1958 pour s’exclure lui-même de la fonction
contentieuse surtout en ce qui concerne le contrôle de constitutionnalité. ‘’
En l’état du droit public français, le moyen de contrariété d’une loi
constitutionnelle de 1875 n’est pas de nature à être discuté devant le CE statuant au contentieux’’. C’est en ces
termes clairs et fermes que la haute juridiction administrative s’affirma dans
l’arrêt Sieur Arrighi et Dame Veuve Coudert du 6 Novembre 1936. Mais bien avant
1936, le CE avait estimé qu’il était incompétent pour contrôler la
constitutionnalité de la loi en 1901 (CE, 23-05-1901) arrêt Sieur Delarue.
Ainsi ce fut le cas en 1901, en 1936, en 1997 (CE, 23-05-1997 GISTI) et plus
récemment en 2005 avec l’arrêt Mlle Deprez (CE, 05-01-2005). Le juge
administratif dans sa fonction contentieuse s’est toujours abstenu et se
reconnait incompétent pour juger de la constitutionnalité d’une loi et donc des actes administratifs pris en
application d’une loi ne peuvent être attaqués en invoquant directement son
inconstitutionnalité.
Le
Conseil Constitutionnel affirma « Il n’appartient pas au juge
administratif d’apprécier la constitutionnalité de la loi » dans une décision
d’Assemblée rendue le même jour que l’arrêt Nicolo.
La
doctrine quant à elle fut très mouvementée. Le président latounerie en
concluant ainsi sur les arrêts Arrighi et Dame Veuve Coudert exprimait avec
force le rôle que le juge administratif entendait alors être le sien dans le
domaine du contrôle constitutionnel des lois étant donné qu’en 1936 cette
solution n’allait pas de soi.
Raymond
Carré de Malberg, Maurice Hauriou ou encore Léon Duguit avaient mené en leur
temps des joutes verbales pour défendre ou condamner le contrôle de
constitutionnalité des lois par le juge administratif.
En
effet, Achille Mestre commentant l’arrêt Arrighi avait raison en son temps mais
l’évolution du droit lui donne désormais tort. Les vérités d’antan ne sont plus
celles d’aujourd’hui. De la fin du référé législatif à l’acceptation du
contrôle de conventionalité de la loi, l’office du juge administratif n’est
plus celui qu’il était avant.
Se
refusant d’abord à devenir le « censeur de la loi » selon
l’expression de Bruno Genevois, il accepta petit à petit de devenir le
protecteur des droits fondamentaux.
Jérôme
Tremeau a mis en lumière cette évolution historique des compétences du juge
administratif face à la loi. Dans son article « la confrontation de
la loi à la constitution par le juge administratif » il montre que le juge
est resté timide vis-à-vis de la loi jusqu'à à la fin des années 1980. On se
rappelle très bien de la guerre des juges depuis la décision Interruption
volontaire de Grossesse de 1975 (Décision 15-01-1975) à laquelle l’arrêt
Jacques Vabres (Cour de cassation 24-05-1975) la même année avait répondu. Le
CE perclus de remords de piétiner ainsi la séparation des pouvoirs si chère à
Montesquieu finit par accepter cette compétence de contrôler fut-ce sur le fondement
du droit International. L’arrêt Nicolo de 1989(CE, 20-10-1989) marqua le
commencement de l’extension des prérogatives du juge. Dix ans plus tard
l’arrêt Sarran fut à son tour décisif.
Cette évolution s’achève provisoirement avec la réforme de 2008 permettant au juge
administratif de filtrer les questions prioritaires de constitutionnalité.
Ainsi
le CE exerçant ses deux fonctions connait des balbutiements, des contestations
qui ont évolué avec le temps et des acceptations. Vu tout ce qui précède et en
tenant compte de l’affirmation de Roland Ricci : « IL nous semble que
la jurisprudence administrative et le contexte normatif ont suffisamment évolué
depuis 1936 pour que la réponse ne s’impose pas d’évidence et mérite un examen
approfondi ».
Le
développement de ce thème sera structuré
en deux chapitres. Dans le premier chapitre nous étudierons le Conseil d’
Etat : juge Constitutionnel accepté dans sa fonction consultative (I) et dans
le second chapitre nous aborderons le Conseil d’Etat : juge constitutionnel
contesté dans sa fonction contentieuse (II).
I-
Conseil d’Etat : juge constitutionnel
accepté dans sa fonction consultative
Le
CE exerce dans sa fonction consultative une mission qui lui est assignée depuis
sa création et une mission récente auprès du parlement. Ainsi nous étudierons
d’une part la fonction de conseiller traditionnel du gouvernement (A) et
d’autre part la fonction de conseiller élargi au parlement depuis la reforme de
2008 (B).
A-
La
fonction de conseiller traditionnel du gouvernement
Le
CE exerce auprès du gouvernement entre autre l’analyse du droit et de
l’opportunité administrative. Ainsi nous étudierons l’appui apporté au
gouvernement dans différents arbitrages (1) et l’aide dans la conduite des
négociations(2 ).
1- L’appui
apporté au gouvernement dans différents arbitrages
Arbitrer
l’action, c’est d’abord arbitrer les questions. En vertu de l’article. L.112-2
du code de justice administrative, « le CE peut être consulté par le
Premier Ministre sur les difficultés qui s’élèvent en matière
administrative ». Devant le risque d’inflation et de désordre lié à
l’afflux des demandes d’avis au conseil, il est apparu nécessaire d’en
rationaliser la procédure : depuis une circulaire du 24 novembre 2003,
les demandes d’avis des ministres
doivent faire l’objet d’une transmission préalable au secrétariat général du
gouvernement (SGG) qui peut s’y opposer.
Conformément
à son rôle traditionnel, le CE est saisi des questions juridiquement complexes.
Il apprécie la pertinence des textes législatifs ou règlementaires face à
l’évolution des jurisprudences du conseil constitutionnel, du conseil d’Etat
statuant au contentieux. Cet examen préventif de légalité confère au texte une
forte crédibilité et sécurité juridique. Dans la forme, le conseil est conduit
à réécrire certains projets dans une langue correcte évitant les ambigüités, sources de contestations
futures. Dans cet exercice, son rôle varie selon les ministères :
moins étoffé auprès de ceux qui sont
juridiquement solides, il sera plus proche des jeunes ministères encore
incertains.
L’administration
cherche ici à conjurer ses peurs en
faisant valider son action pour prévenir un contentieux de légalité,
indemnitaire ou pénal. Lorsqu’un ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques
Aillagon, souhaite prendre la direction d’une chaîne de Télévision, TV5 Monde, face aux critiques
du Syndicat national des journalistes, le gouvernement demande l’avis du CE par
crainte d’une plainte déposée au pénal. L’article 175 du code pénal interdit en
effet à tout fonctionnaire public, pendant un délai de cinq (5) ans après la
cessation de ses fonctions , de recevoir des sociétés directement soumises à
son contrôle une participation par travail, conseils ou capitaux . Le CE
observe dans son avis du 22 mars 2005, que l’expression
« fonctionnaire public » n’ayant pas dans le texte originel de la loi
1919 le sens le plus large, l’énumération des auteurs d’une telle infraction a
dû être complétée par différents textes.
Il
en déduit qu’un ministre n’est pas fonctionnaire public ni un agent ou préposé
d’une administration publique au sens de l’article 432-13 du code pénal, il ne
peut donc relever de ce type d’infraction.
Il
s’agit parfois d’anticiper un
contentieux constitutionnel. Le respect des procédures et le choix d’une
temporalité conditionnent la réussite
d’un projet gouvernemental. Dans son avis du 23 Mai 2006, le CE répond à deux
sollicitations. Le conseil Supérieur de l’audiovisuels peut-il abroger par
décret une autorisation d’usage de la
télévision par voie hertzienne au bénéfice du déploiement de la télévision numérique ou cela doit-il se faire par une
loi ? A quelles conditions cette modification peut-elle être effectuée
pour assurer le respect des droits des
éditeurs de services et des téléspectateurs ? Le gouvernement cherche en
fait une réponse à deux questions connexes celle de la chronologie de sa
réforme ; celle des risques financiers qu’il court en terme
d’indemnisation. Sur le premier point, la réponse du CE dicte la temporalité de
la réforme : puisque la loi est nécessaire, elle sera présentée au
parlement à l’été 2006, le projet relatif à la modernisation de la diffusion
audiovisuelle et à la télévision du futur étant adopté le 05 Mars 2007. Les conditions d’indemnisation différent
selon les bénéficiaires des précédentes autorisations : les coûts des
éventuels réaménagements de fréquence peuvent être mis à la charge des éditeurs
de service ; en revanche, ils ne doivent pas priver les téléspectateurs de
la continuité de la réception des programmes. Le texte de loi précise donc que
si le passage au tout numérique pour la télévision doit être achevé en France
au 30 Novembre 2011, un fond d’aide spécifique est crée pour aider les
téléspectateurs les plus modestes à acheter un nouvel équipement. Solliciter le
conseil avant le dépôt du projet de loi permet au gouvernement d’obtenir des
réponses précises à des questions que le juge aurait évitées en cas d’avis
formel sur le projet de loi. De telles considérations tactiques évitent
l’inconstitutionnalité d’un texte.
Des
questions sensibles conduisent le gouvernement à solliciter le conseil pour
obtenir indirectement un appui dans l’exercice même de ses fonctions
d’arbitrage.
Certains
projets en raison de leurs conséquences polémiques ne peuvent que bénéficier de
l’assurance juridique du conseil. La surpopulation carcérale impose la
construction rapide d’établissements pénitentiaires. Mais l’Etat ne dispose pas
des moyens financiers suffisants et décide de recourir à de nouveaux modes de
passation des marchés publics ; les partenariats public-privé (PPP) :
le bénéficiaire se voit confier la compétition, la construction, et la gestion
des bâtiments pendant une durée de vingt à trente ans. Titulaire d’une
convention de bail accompagnée d’une autorisation d’occupation temporaire, le
candidat retenu sera propriétaire de l’Etablissement que l’Etat louera pendant
deux ou trois décennies. A l’issue de cette période la puissance publique
disposera d’une option d’achat pour acquérir des bâtiments construits. Les
services inhérents au fonctionnement des prisons, restauration, entretien des
locaux, nettoyage seront pris en charge dans le contrat global. L’avantage est
énoncé : permettre la construction rapide de l’équipement public ; en
diminuer les coûts en regroupant l’investissement et la maintenance ;
toutefois, c’est une personne privée qui assure la construction et le
fonctionnement pendant la durée du bail et la charge financière de
l’investissement est reportée sur les générations futures.
Ces
aspects nécessairement polémiques
surtout lorsqu’il s’agit de bâtiments qui se rattachent à l’exercice
d’une fonction régalienne, méritaient un étai juridique. Le gouvernement a donc
sollicité le Conseil pour savoir si les
constructions de prison sur le fondement des PPP, devaient être regardées comme
entreprises pour le compte de l’Etat. La réponse positive, liée au droit de
l’urbanisme et rendue dans l’avis de 6 Septembre 2005, confirme la pratique du
gouvernement qui, quelques jours après la parution, le 27Juillet 2004, du
décret d’application précisant les règles de passation des PPP, avait annoncé
que quatre établissements pénitentiaires allaient être construits et gérés dans
ce cadre.
La
saisine peut répondre à la nécessité de faire arbitrer par le Conseil un
dossier sur lequel deux ministères s’affrontent et de sortir ainsi d’une
situation enlisée. Entre le ministère des anciens combattants favorables à la prise
en compte d’une bonification pour les militaires ayant fait une campagne en
Algérie et Bercy qui la refuse, une guerre de tranchée s’est installée. Après
un rapport incertain de l’inspection générale des affaires sociales, le SGG
tente de sortir de cet imbroglio en « laissant filer » une demande
d’avais au Conseil. L’avis du 30 Novembre 2006 rappelle que la loi du 18
Octobre 1999, en qualifiant le conflit en Algérie de « guerre » a
crée une situation juridique nouvelle dont le gouvernement doit tirer les
conséquences, indépendamment des différentes modalités proposées dans le
rapport de l’IGAS qui ne peuvent être retenues en l’état pour des raisons
juridiques. Le Conseil invite donc le gouvernement « à définir les
circonstances de temps et de lieu permettant d’identifier les situations de
combats qui pourraient ouvrir droit au bénéfice de la campagne double ».
Cet avis tempérée n’est doute pas porteur de clarification souhaitées.
Le
gouvernement peut aussi se défausser sur le Conseil d’une responsabilité qu’il
ne souhaite pas prendre. Lorsque la cour des comptes affiche sa volonté de
contrôler les barreaux, soutenant que sa compétence s’étend aux organismes
habilité à percevoir des cotisations légalement obligatoires, le ministère de
la justice et le conseil national des barreaux contestent cette position en
rejetant le caractère « légalement obligatoire » des cotisations
fixés par la loi du 31 Décembre 1971 ; certains barreaux n’en perçoivent
pas et d’autres en envisageant la suppression. Ce conflit plus essentiel qu’il n’y parait, renvoie à la
nature même des barreaux et à la garantie d’indépendance des avocats. Matignon,
saisi par la cour des comptes mesurant le coût politique d’une réponse
défavorable imposée au ministère de la justice, ne souhaite pas rendre
directement cet arbitrage. Le SGG laisse le ministre de la justice saisir le Conseil
en 2006, ce qui lui confère un double avantage : affirmer son attachement
à l’indépendance des avocats ; économiser son crédit auprès du ministère
de la justice. L’avis du Conseil confirme la position de la Cour des Comptes.
Le
CE jouant le rôle de conseiller du gouvernement examine les projets de loi
comme l’impose l’article 39 de la constitution et les projets d’ordonnance
(article 38 de la constitution) avant qu’ils ne soient soumis aux conseils des
ministres. Il connait également des projets de décret les plus importants,
qualifiés de « décret en Conseil d’Etat ». Son avis porte sur la
régularité juridique des textes leur forme et leur opportunité non politique mais
administrative.
Toutefois,
il peut être consulté par le gouvernement sur toute question d’ordre juridique
ou administratif. Ce fut récemment le cas en Janvier 2010, le Premier Ministre
saisit la haute juridiction quant à la possibilité juridique d’interdire le
port du voile intégrale dans l’espace public.
Enfin,
le gouvernement peut souhaiter donner du poids à une décision qui ne présente
pas par ailleurs de grandes difficultés juridiques. Lorsque la question s’est
posée de savoir qui de l’Etat ou des communes devait supporter les charges de
reprographie au sein des écoles primaires, ce ne fut pas la complexité
juridique qui arrêta le SGG, l’argument selon lequel ces charges découlaient
d’initiative des enseignements dans le cadre de leur mission, étant sans
incidence sur le texte de loi. L’avis du 14 Janvier 2003 confirme que les
reprographies réalisées dans les écoles du premier degré doivent être
considérées comme du matériel d’enseignement à la charge des communes. Le
gouvernement avait en fait sollicité le Conseil pour ne pas heurter de front l’Association des maires
de France.
Dans
les multiples déclinaisons de l’action gouvernementale y compris pour
déclencher la refonte des règles devenues trop complexe et ingérables, le gouvernement cherche auprès du Conseil un
appui dans les postures arbitrales qu’il adopte mais aussi dans les
négociations.
2-
L’AIDE
DU CONSEIL D’ETAT DANS LA CONDUITE DES NEGOCIATIONS
Les
réformes au sein de l’union Européenne sont toujours précédées de larges
consultations. C’est dans ces temps d’émergence des propositions et de
maturation des textes que la France doit réagir car c’est alors que les marges
des manœuvres et d’inflexions sont les plus importantes (voir rapport public, « l’administration
française et l’Union européenne quelles influences ? Quelles
stratégies ? » EDCE, n° 58 la documentation française, 2007). Pour
intervenir très en amont le gouvernement peut s’appuyer dans sa capacité à
négocier sur les avis du Conseil d’Etat.
La
procédure issue de l’article 88-4 de la constitution invite le gouvernement à
demander l’avis du Conseil pour discerner dans les propositions d’actes
communautaires, les dispositions de
nature législative. Au-delà de cette détermination, le Conseil avait
initialement alerté le gouvernement sur la portée de certains textes. Cette
pratique est partiellement tombée en désuétude du fait des délais d’examen très
bref impartis aux sections administratives. Il est donc apparu nécessaire de
prévoir une nouvelle procédure : la circulaire du 30 Janvier 2003 définit
les modalités de saisine du Conseil sur les propositions d’actes communautaires
dont le contenu est susceptible, d’avoir un impact important en droit interne
par des difficultés prévisibles lors de la transposition ou la nécessité
éventuelle de modifier la constitution.
Ces
avis contribuent à forger, par un faisceau d’inspiration concordante, une
position unifiée des autorités françaises fortes utiles dans le cadre d’une
négociation communautaire ou internationale. Les observations du Conseil auront en effet d’autant plus
d’échos que transmises au parlement, elles seront bien souvent relayées dans
les résolutions adoptées.
Dans
son avis du 10 Juin 1993 sur la directive relative au traitement des données à
caractère personnel et à leur libre circulation, le conseil « a
estimé utile d’attirer l’attention du gouvernement dans la perspective des
négociations relatives à l’élaboration de cet acte sur ces difficultés
juridiques ».
Afin
de prévenir tout risque d’inconstitutionnalité de la future loi de
transposition, il conviendrait de veiller à ce que la directive ne contienne
pas des dispositions qui conduiraient à priver des principes de valeur
constitutionnelle de la protection que leur accorde la loi du 6 Janvier 1978 « certaines pourraient conduire à une
régression du niveau de protection jusqu’ici accordée à ces principes en droit
interne ». L’attention était ainsi attirée sur différents articles du
projet ; la protection des données, le traitement des données sensibles,
le fichage des condamnations pénales. L’Assemblée Nationale et le Senat
ont voté des résolutions de même inspiration, ce qui a eu une réelle influence
dans la capacité de la France à négocier la rédaction de la directive du 24
Octobre 1995.
Le
gouvernement se trouve confronter dans ses capacités de négociation par les
éléments de contenu que lui transmet le CE. Lorsque l’Assemblée générale du
conseil, dans son avis du 29 Avril 2004, se prononce sur l’élargissement du
champ d’application du principe non bis in dem dans une proposition du Conseil
de l’Union Européenne, il attire à cette occasion l’attention du gouvernement
« sur le caractère incomplet des dispositions de la proposition de
décision cadre relative aux cas de litispendante ». Une solution plus
satisfaisante devait être apportée en conférant un rôle essentiel à la règle de
la territorialité avant que ne soient tirées toutes les implications de cette
règle à l’échelle de l’Union.
La
ratification du protocole de Londres sur l’application de l’article 65 de la Convention
de Munich de 1973 relative aux brevets européens qui réunit 31 membres au-delà
de l’Union Européenne, a soulevé de
vives polémiques. Un brevet est composé
de deux parties principales : les revendications qui définissent l’étendue
de la protection et la description qui détaille les aspects techniques mais
n’est pas constitutive du droit au brevet. En cas d’entrée en vigueur de
l’accord, la France ne renoncerait qu’à la traduction de la description de
l’invention. Par contre, des brevets délivrés en français seraient validés dans
les autres Etats, avec l’exigence de traduction des seules revendications. Les
tenants d’une politique volontariste de
l’innovation se sont ici opposés aux hérauts de la francophonie qui estimaient
qu’en dispensant de traduire en français la description de l’invention,
l’accord serait contraire à la constitution. Selon l’avis du Conseil rendu le
21 Septembre 2000, aucune stipulation de cet accord n’oblige les personnes de
droit public et de droit privé dans l’exercice d’une mission de service public
français, à utiliser une langue autre que le Français et aucune ne confère aux
particuliers, dans leurs relations avec les administrations et services publics
français, un droit à l’usage d’une langue autre que le français. Cet accord,
qui s’inscrit dans le cadre de relations de droit privé entre le titulaire d’un
brevet et les tiers intéressés n’est donc pas contraire à l’article 2 de la
constitution. Dans une décision de 28 Septembre 2006, le Conseil Constitutionnel
(C-C) reprend l’avis du CE pour autoriser les ratifications de cet accord sans
révision préalable de la constitution.
La
position du gouvernement sera d’autant plus forte que prenant appui sur les
avis du Conseil, il sera en capacité d’agir en amont de la procédure
d’élaboration des textes.
La
directive Bolkestein, relative aux services dans le marché intérieur, est
emblématique de cette nécessaire prise en compte de la chronologie
administrative. Afin d’assurer la libre circulation des services sur le marché
européen et d’éliminer les barrières qui en empêchent la pleine application, le
projet initial proposé par la commission en Janvier 2004 reposait sur le
principe dit du pays d’origine : la loi applicable à un prestataire de services ne serait plus
celle de l’Etat d’origine du prestataire. Ces dispositions ont rapidement
opposé les pays d’Europe centrale et orientale désireux de profiter de leurs
avantages comparatifs aux Etats membres de la vieille Europe qui craignaient un
nivellement par le bas du model social européen. Dans un avis rendu en
Assemblée générale le 18 Novembre 2004 le CE souligne l’imprécision du contenu
du projet de directive : « en définitive, l’application du
pays d’origine du prestataire de service devrait être modifiée dans son
approche : il conviendrait de dresser une liste positive des cas dans
lesquels ce principe pourrait être appliqué dans des condition satisfaisantes,
au lieu de poser le principe de l’application de la loi du pays d’origine tout
en dressant une liste d’exclusions hétérogènes et sans doute incomplète ».
L’avis du Conseil a été relayé de manière explicite par deux résolutions du
parlement Français ; celle adoptée le 23 Mars 2005 par le Senat
« rappelle les réserves du CE » et celle de l’Assemblée Nationale en
date du 15 Mars 2005, « demande résolument d’abandon du principe du pays
d’origine ». Sans doute la rue avait-elle –déjà dit son hostilité à cette directive mais il faudra attendre le
16 Février 2006 pour que le parlement
européen adopte un compromis qui renverse complètement l’approche initiale. Le
sort du référendum du 29 Mai 2005 eût peut être été différent si le
gouvernement français dès le départ s’était appuyé sur l’analyse du CE pour
manifester son opposition à la rédaction initiale de la directive.
La
fonction consultative de CE témoigne dudit et du non-dit : ce qui est
légitimement attendu, de l’analyse du droit et de l’opportunité administrative,
côtoie le sous –jacent : l’appui
apporté au gouvernement dans différents arbitrages et l’aide dans la conduite
de négociations. Autorité morale, l’institution est un acteur majeur du
processus de décision gouvernementale. Mais outre ce rôle il exerce des
activités bien entendues au sein du parlement.
B-
La
fonction de conseiller élargi au parlement depuis la reforme de 2008
La
procédure législative nécessite l’intervention de nombreux acteurs. Le
gouvernement et le parlement y jouent,
bien évidemment un rôle central. Ils sont les seuls détenteurs du
pouvoir d’initiative législative selon le premier alinéa de l’article 39 de la
constitution, le parlement est, par ailleurs, le seul compétent pour adopter
les projets et propositions de loi. Mais la complexité croissante du droit
implique aujourd’hui qu’auparavant, l’intervention de divers experts et
l’assistance dans les prises de décisions. Le processus d’élaboration des lois
n’échappent guère à cet impératif. Parmi ces acteurs, auxquels on n’apporte pas
toujours une attention suffisante mais qui concourent incontestablement à
l’élaboration de la loi, le CE occupe une place essentielle. L’implication du
CE dans la procédure législative n’étant pas récente, nous étudierons d’une
part la conception classique de cette fonction (1) et d’autre part l’évolution
marquée par la réforme de 2008 (2).
1- La
conception classique de cette fonction
La
fonction de conseil des autorités publiques qu’il remplit est à l’origine même
de l’institution. C’est d’ailleurs celle qui s’est affirmée d’abord dans
l’article 52 de la Constitution du 22 frimaire de l’an VIII qui a habilité le
CE à « rédiger les projets de lois et les règlements d’administration
publique et (à) résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière
administrative ».
En
effet au fil du temps, les contours de cette attribution sont restés
relativement stables, un nombre limité de réformes est venu la modifier,
l’ajuster ou la réviser sans apporter de chargements considérables.
La
Constitution en son article 83 bis donne sa mission au CE : « donner
son avis sur les projets et propositions de loi et les amendements… ainsi que sur
toute autres questions qui lui sont
déférées par le gouvernement ou par les lois ». La loi du 12 Juillet 1996
portant réforme du CE précise dans ses
articles 2 et 3 les attributions en matière législative et règlementaire. Voici
des extraits de l’article 2 : « aucun projet ni aucune proposition de
loi ne sont présentées à la chambre des députés et sauf le cas d’urgence à
apprécier par le Grand. Duc, aucun projet de règlement pris pour l’exécution
des lois et des traités ne sont soumis au grand duc qu’après que le
CE a été entendu en son avis. Cet avis est donné par un rapport motivé
contenant des conclusions et le cas
échéants, un contre-projet. S’il estime un projet ou proposition de loi
contraire à la constitution, aux conventions et traités internationaux, ainsi
qu’aux principes généraux de droit (PGD), le CE en fait mention dans son avis.
Il en fait de même s’il estime un projet de règlement contraire à une norme de
droit supérieure ». Quant à l’article3 il dit ceci : « le
gouvernement avant de soumettre au CE un projet de loi en règlement, peut
demander son avis sur le principe ».
En
pratique comment cela se passe-t-il ? Un projet de loi est soumis par le
Premier Ministre au CE. Une première discussion générale à lieu de préférence
après l’obtention des avis obligatoires des chambres professionnelles et
d’autres instances ayant reçu cette compétence par leur loi organique. C’est le
cas par exemple du collège médical pour ce qui touche à la santé ou du Conseil National
des étrangers pour tout ce qui traite du droit des étrangers. Le secrétariat
complète aussi le dossier par les textes législatifs afférents en vigueur et le
cas échéant dans nos pays voisins. En fonction de la complexité et de la
« sensibilité » du projet la lecture et la discussion se fait soit
globalement, soit article par article, facilitant la rédaction d’un projet
d’avis par le rapporteur. Ensuite, nourri par la réflexion et la discussion
collective, par les textes existants, il appartient au rapporteur de chercher
en plus de la documentation scientifique nécessaire pour l’éclairer davantage,
avant de se mettre à la formulation d’un projet d’avis. Ici encore, le
secrétaire de commission et la responsabilité de la bibliothèque rendent de
bons services. Enfin une fois rédigée et approuvé phrase par phrase par les
membres de la commission pour ensuite
passer en assemblée plénière. Si l’avis suscite de grandes discussions, il est renvoyé en
commission en vue de rechercher du
consensus. Ceci explique aussi pourquoi les avis minoritaire sont rares. Lors
du vote sur les avis, il arrive que des conseillers d’Etat s’abstiennent pour
avoir participé en une autre qualité à l’élaboration du projet en
question ; ceci dans le respect de la
séparation des pouvoirs. Les amendements gouvernementaux ou
parlementaires passent les mêmes chemins mais à une vitesse supérieure parce
qu’une connaissance approfondie du dossier est déjà donnée.
Pour
les propositions de loi émanant d’un membre de la chambre des députés ; le
CE demande au préalable une prise de position du gouvernement. Si une prise de
position gouvernementale fait défaut, le CE avise ces propositions de loi selon
le même schéma que décrit plus haut, si possible conjointement à des projets de
loi ayant trait à des matières similaires. Quant aux directives à transposer en
droit national, le CE veille à une transposition correcte, c’est –à-dire en suivant de près les normes communautaires
données et en faisant usage des stipulations qui laissent un vrai choix aux
Etats membres. Un exemple récent a été la discussion sur le droit au travail
des demandeurs d’asile pour lequel la directive laissait une certaine latitude.
Mais
cette fonction s’est vue élargie avec la réforme de 2008.
2-
L’évolution
marquée par la réforme de 2008
Cet
aspect du rôle du CE dans le processus législatif se trouve en question depuis la loi Constitutionnelle
n* 2008-724 du 23 Juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème
République (J.O, 24 Juillet 2008) qui a introduit à la fin de l’article 39 de
la constitution la brève mention suivante : « Dans les conditions
prévues par la loi, le président d’une assemblée peut soumettre pour des avis
au CE, avant son examen en commission, une proposition de loi, déposée par l’un
des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose ».
L’élargissement de la mission consultative est donc accordé au CE. La
disposition constitutionnelle a été complétée par la loi n°2009-669 du 15 Juin
2009 tendant à modifier l’ordonnance n° 58-1100 du 17 Novembre 1958 relative au
fonctionnement des assemblées parlementaires et à compléter le code de justice
administrative qui a fixé les conditions selon lesquelles cette consultation
pour avis du CE peut avoir lieu. Les dispositions suivantes y étaient
introduites : il est procédé à l’examen de proposition de loi selon la
procédure habituelle, c’est-à-dire en principe par l’une des sections
administratives du CE pris par
l’Assemblée Générale(CJA, article L123-1) ; lors de cet examen, l’auteur
de la proposition peut produire toutes observations, être entendu par le
rapporteur et participer avec voix consultative aux séances desquelles l’avis
du CE est délibéré (CJA article L123-2) ;l’avis émis par le CE est adressé
au Président de l’Assemblée qui l’a saisi, qui le communique à l’auteur de la proposition
(Ordonnance n°58-1100,17 Novembre 1958), article 4 bis , journal officiel 18
Novembre 1958), ainsi informé, l’auteur de la proposition dispose d’un délai de
cinq jours francs pour s’y opposer (Ordonnance n°58-1100, 17 Novembre 1958). Le
décret du 29 Juillet 2009 a également modifié la partie règlementaire du Code
de Justice Administrative pour y apporter des ajustements de coordination et de
détail de la nouvelle procédure consultative.
Cette
réforme des attributions consultatives du CE, s’inspirant de la loi du 3 Mars
1849 qui autorisait le CE à formuler « un avis sur les projets de loi
émanant soit de l’initiative parlementaire soit du gouvernement, que
l’Assemblée Nationale juge à propos de lui renvoyer » est perçue comme
une : « réelle innovation » dans le cadre de la Vème République. Ainsi, lorsque le CE émet un avis
sur une proposition de loi, il exerce incontestablement une fonction de conseil
législatif et grâce à cette fonction, il est placé aujourd’hui « au cœur
des pouvoirs publics ». C’est un dialogue inédit qui est instauré entre le
parlement et le CE, conseiller traditionnel du gouvernement.
Cependant,
l’impact réel de cette réforme est à déterminer.
En
effet, la réforme initiée par la loi Constitutionnelle du 23 Juillet 2008 se
présente comme une extension de la fonction de conseiller législatif du CE au
–delà des initiatives gouvernementales aux initiatives parlementaires. C’est
l’objectif principal de la réforme : améliorer le travail législatif en
renforçant le pouvoir d’appréciation et de décision et la capacité d’expertise
du parlement, tout en accentuant le poids du Conseil dans le processus
d’élaboration de la loi. Le CE voit ainsi « son rôle évoluer dans le
sens d’une participation généralisée à la fonction législative se traduisant
par l’exercice d’un contrôle a priori de l’initiative des lois. […],
c'est-à-dire avant son intervention au
contentieux ou l’intervention du Conseil Constitutionnel » (confère
A.Roblot-Troisier, J.-G Sorbara, op.cit ; p.1996). De même il ne faut pas oublier que, lorsqu’il
rend des avis au gouvernement et au Parlement, il exerce incontestablement sa
troisième fonction, aux cotés de sa fonction administrative et de sa fonction
juridictionnelle. Cette fonction est de nature législative et revient en dernier
lieu à l’Assemblée Générale après examen par une section administrative
(confère dans le même sens V.A. Roblot-Troisier, J,-G ; sorbara, ibid.).
En
effet, comme lors de l’examen des projets de loi, ici aussi le CE doit être
perçu comme un organe indépendant, exerçant une fonction de conseil législatif.
Tout d’abord, le CE livre une expertise juridique du texte-projet ou
proposition de loi-qui lui est soumis. Il se contente d’exprimer le droit,
« il ne procède pas à une critique de la norme, sinon du point de vue
technique et juridique » (confère P.Gonod, « le CE, conseil du
parlement. A propos de l’article 39 al 3 de la constitution » RFDA,
2008.p.872)
En
tant que conseiller du parlement, le CE s’est également prononcé sur des
dispositions de diverses natures. La première saisine dans le cadre de la
nouvelle procédure est un exemple par excellence de l’étendue des domaines que
la consultation peut couvrir. Le CE s’est prononcé sur 150 articles tendant à
améliorer la qualité des normes et des relations des citoyens avec des
administrations ; à clarifier et à simplifier le régime juridique des
groupements d’intérêt public ; à simplifier le droit de l’urbanisme ; à tirer les
conséquences du défaut d’adoption des textes d’application prévus par certaines
disposition législatives ;à simplifier et à clarifier notre législation
pénale, à améliorer la qualité formelle du droit ; et à modifier diverses
dispositions législatives. Le Conseil d’Etat a entendu accomplir sa nouvelle
fonction de manière complète comme il a l’habitude de le faire pour les projets
de loi. Loin de se borner a formulé un simple avis qui porte la mention
« favorable » ou « défavorable » et sans connaître de frontières
précises, le CE contrôle les textes qui lui sont soumis a trois niveaux :
le droit, l’opportunité et la forme.
Le
CE se livre à une recherche de l’impact de la proposition de loi sur la
sécurité juridique. Il vérifie notamment le respect des normes de droit
supérieur-la Constitution, les textes de l’Union Européenne ; la
Convention Européenne et ou tout autre
texte de Droit International que la France a signé et intégré dans l’ordre
juridique interne. Il vérifie également si la proposition de loi s’articule
correctement avec le droit existant. Il contrôle enfin la bonne application des
dispositions nouvelles dans le temps et dans l’espace.
Le CE s’engage également dans une recherche de
l’ « opportunité » législative et administrative du texte qui lui
est soumis. Il examine la cohérence tant interne qu’externe de la proposition
de loi ainsi que la pertinence des solutions retenues au service des objectifs
du texte. Il apprécie la possibilité de mettre en œuvre efficacement ces objectifs.
En ce qui concerne le dernier niveau de son
contrôle, le CE procède non seulement à une correction purement formelle mais
également à une correction juridique des projets et des propositions de loi qui
lui sont soumis. Il peut être conduit à suggérer une nouvelle rédaction de
certains passage dans une langue correcte et précise « évitant les
ambiguïtés sources de contestations futures » (Confère N.
Belloubet, » « CE » in le
conseil d’Etat, pouvoir, n°123 P.35). Le CE s’attache à vérifier si le texte
s’insère correctement « à sa place, par rapport notamment aux textes
et aux codes existants » (confère M. Long, op.cit.p.788). Il tient à ce
que les textes soient d’une parfaite qualité du point de vue du droit.
La nouvelle compétence consultative qui fait du CE
conseiller du parlement, lors des débats entourant la mise en place de la
réforme, plusieurs amendements relatifs à la publicité des avis du CE ont été
proposés. Quelques parlementaires avaient même suggéré la publicité de
l’ensemble des avis rendus par le CE sur les projets comme les propositions de
loi. Sur ce point le CE a considéré dans le tout premier avis rendu, que la question de la publicité à
réserver à ses avis relève de la seule compétence des organes de l’Assemblée
parlementaire qui l’ont saisi. Ces avis dont le CE est tenu de rendre revêtent
une forme particulière. Les avis rendus dans le cadre de la nouvelle procédure
ont permis d’observer que leur forme n’est pas celle habituellement adoptée
pour l’examen des projets de loi. Le CE n’a pas procédé « à la réécriture
complète du (texte), assortie le cas échéant d’une note explicative »
ainsi qu’il est d’usage pour les projets de loi ou de décret pour lesquels
l’avis du CE s’exprime essentiellement par la mise au point et l’adoption
d’un projet alternatif (Confère R. Bouchez op.vit.n°35). En effet, à l’occasion
de l’examen de la première proposition de loi portant sur la simplification et
l’amélioration de la qualité du droit, le CE a passé en revue les dispositions
transmises en suggérant des reformulations, mais sans proposer de nouvelle
rédaction d’ensemble. Pour la deuxième proposition de loi, le CE ne s’est pas
écarté de cette ligne de conduite ‘(confère V. Rapport 2297 de l’Assemblée
Nationale). Par conséquent « l’usage qui naît de la répétition, se trouve
ainsi établi » : les avis rendus dans le cadre de la nouvelle
procédure consultative comportent donc des observations générales pris des
remarques article par article, assorties le cas échéant de proposition de
rédaction (il faut noter ici que le CE, saisi par le gouvernement, a rendu un
avis le 20 Juin 1967, sur une proposition de loi tendant à modifier les limites
des départements de l’Ain, de l’Isère et du Rhône (Loi n° 67-1205 du 29
Décembre 1967 modifiant les limites de
département de l’ Ain ,de l’Isère et du Rhône) dans lequel il avait procédé à
un examen proche de celui qu’il a retenu pour les avis rendus dans le cadre de
la nouvelle procédure de consultation puisqu’il n’a alors pas réécrit le texte
mais formulé une suggestion de rédaction). Certains auteurs expliquent à juste titre que «
cette différence de prestation a de fortes justification, qui tiennent au
moment auquel intervient l’avis au CE dans la procédure législatif (R. Bouchez
op.cit.n° 36 et 37). Le moment de la saisine du CE n’influe pas uniquement sur
la forme de l’avis, mais également sur l’étendue du contrôle qu’il peut
déployer. Le CE estime qu’il ne lui appartient pas dans le cadre de la nouvelle
procédure consultative d’examiner les questions de recevabilité financière que peuvent
soulever les dispositions de la proposition de loi étant soumise au CE pour
avis après son dépôt, il résulte des règlements de l’Assemblée nécessairement
déjà fait l’objet d’un examen et d’une décision positive de la part des
instances de l’Assemblés au sein de laquelle elle a été déposé (V. sur ce point
R.Bouchez ; op.cit.n° 38 et 39). La consultation ne peut intervenir
qu’après dépôt de la proposition et
avant sont examen en commission, de sorte que l’initiative du ou des
parlementaires auteurs de la proposition est déjà « cristallisée » (R.Bouchez
op.cit. N°36 et 37) par un texte et rendue publique et que la procédure
parlementaire est déjà engagée sur cette base. Par conséquent la proposition de
loi déposée ne peut être modifiée que lors de son examen en commission puis en
séance publique. Il est donc « institutionnellement normal que le CE ne
‘’ s’empare’’ pas du texte comme il peut le faire pour un projet de loi ».
En revanche lorsqu’un projet de loi est soumis au CE, ce n’est en réalité« qu’un
avant projet de loi du gouvernement, en
place de confection qui n’a pas encore vraiment d’existence
institutionnelle ». Il peut être facilement modifié ou amputé de certaines
de ses dispositions.
La collaboration entre les assemblées et le CE
s’avère beaucoup plus complexe dans la mesure où celui-ci se présente comme
« une institution placée au cœur du pouvoir exécutif ».Certes, le
contexte institutionnel politique a rangé depuis longtemps « le
CE aux cotés d’un exécutif qui partage
avec le parlement l’exercice de la fonction normative ». Placé au cœur du
pouvoir exécutif le CE est perçu comme un usurpateur ; comme une menace
potentielle.
Malgré tout dans sa fonction consultative, le CE est
bien accepté et exerce pleinement ses activités tant au près du
gouvernement qu’auprès du parlement.
Qu’en est- il de sa fonction contentieuse ?
II-CONSEIL
D’ETAT : JUGE CONSTITUTIONNEL CONTESTE DANS SA FONCTION CONTENTIEUSE
Le juge dans sa fonction contentieuse est amen
é à connaître des litiges impliquant des normes
constitutionnelles voire législative. Il est donc amené à connaitre ces litiges
qui ont entrainé de possible refus. Nous étudierons donc d’une part la fonction
de juge constitutionnel refusé (A) et d’autre part la fonction de juge
constitutionnel pratiqué (B)
A-
La
fonction de juge refusé
Le problème ici est de savoir s’il est possible au
CE de juger de l’inconstitutionnalité d’une loi ; s’il peut intervenir
dans le contrôle de constitutionnalité ; bref si dans sa fonction
contentieuse il est devenu un juge constitutionnelle. Ainsi nous étudierons le
principe posé par l’arrêt Arrighi d’une part (1) et d’autre part le débat
doctrinale sur la position du CE (2)
1-
Le
principe posé par l’arrêt Arrighi
En
l’espèce, M. Arrighi a effectué dans l’armée ainsi que pour des métiers civils,
un total de trente ans de service ; de ce fait, deux Décrets des 4 Avril
et10 Mai1934 pris en l’application de l’article 36 de la loi du 28 Février 1934, le placent à la
retraite d’office. Il s’agit ici de la mise en œuvre de la procédure
particulière du décret. La loi du 28 Février 1934 étant une« loi
d’habilitation » autorisant le gouvernement à intervenir dans des domaines
normalement réservés au pouvoir législatif, M. Arrighi souhaite alors contester
ces deux décrets.
L’état
de droit est la soumission d’une société à son droit. Pour les autorités
compétentes pour édicter des normes, l’état du droit signifie aussi le respect
de la hiérarchie des normes. Ainsi le CE semble avoir pris cette décision avec
réticence, en évoquant l’état du droit public
français en ces termes clairs et
ferme : « En l’état actuel du droit public français, le moyen de
contrariété d’une loi constitutionnelle
de 1875 n’est pas de nature à être discuté devant le CE statuant au
contentieux ». Le CE se reconnaît donc incompétent pour juger de la
constitutionnalité d’une loi et donc les actes administratif pris en
application d’une loi ne peuvent être attaqués en invoquant directement son
constitutionnalité.
En
effet, l’incompétence du juge dans l’arrêt Arrighi se fonde sur l’article 61 de
la Constitution du 04 Octobre 1958 : «considérant que l’article 61 de
la Constitution du 4 Octobre 1958 a confié au Conseil Constitutionnel
(CC) le soin d’apprécier la conformité d’une loi à la Constitution ; que
ce contrôle est susceptible de s’exercer après les vote de la loi et avant sa
promulgation ; qu’il ressort des débats tant du comité consultatif
constitutionnel que du CE lors de l’élaboration de la constitution que les
modalités ainsi adoptés excluent un contrôle de constitutionnalité de la loi au
stade de son application. En plus le juge administratif étant le juge de
l’administration donc de l’exécutif, il ne
peut en vertu de la séparation
des pouvoirs, se permettre de censurer un acte pris par le pouvoir législatif :
il est le serviteur de la loi et non son juge. Le CE n’aura pas attendu 1958 et
la création du Conseil Constitutionnel pour s’exclure lui-même du contrôle du
constitutionnalité. Ainsi donc parmi les actes des assemblées elles-mêmes
figurent au premier rang, les lois qui, adoptée exactement dans l’exercice du
pouvoir législatif ne peuvent être contrôlées par le juge administratif non
plus par le juge judiciaire, ni par voie d’action ni par voie d’exception. En
particuliers l’exception d’inconstitutionnalité n’a jamais prospéré devant les
juridictions de droit commun. L’incompétence de la juridiction administrative
peut toutefois s’expliquer sur deux sortes de considérations :la première
tient à la« souveraineté » du parlement qui serait incompatible avec
le contrôle de quelque juridiction que ce soit ; la seconde vient de ce
que le juge administratif compétent à l’égard des autorités administratives ne
peut l’être envers les autorités parlementaires, dont le statut, les fonctions
relèvent du législateur. Ces raisons ont peut être prévalu non seulement sur
les actes adoptés par les Assemblées mais aussi ceux qui émanaient de certains
de leurs organes.
Par
ailleurs, le juge administratif s’est toujours refusé à exercer un contrôle de
constitutionnalité de la loi, de crainte d’entrer en conflit avec le
législateur, conscient du fait que la position qui était la sienne pouvait ne
pas permettre une pleine application de l’article 55 de la Constitution.
En
l’espace Arrighi, le problème s’est posé de savoir si le CE est compétent pour
juger si le décret est conforme à la Constitution. Le CE a affirmé la théorie dite de la loi écran,
refusant le Contrôle de Constitutionnalité d’un acte règlementaire pris en
application d’une loi. Il en découle que la loi fait en quelque sorte ‘’ écran
‘’ entre la Constitution et l’acte administratif (Ici le décret). Tout ceci
rend compte de la conception traditionnelle. Le juge administratif n’est pas
étranger à la Constitution mais n’a pas la compétence qu’a le juge constitutionnel
qui n’est autre que le pouvoir de sanction. Le juge administratif peut
interpréter la Constitution et la loi,
mais la seule institution autorisée à abroger la loi c’est le Conseil Constitutionnel.
On peut aussi traduire cela de la façon suivante. Le juge administratif rend
des décisions qui n’ont que l’autorité relative de la chose jugée.
Si
la Constitution a désigné une seule et unique institution compétente pour avoir
connaissance de la constitutionnalité de la loi cela signifie à contrario
qu’aucune autre institution n’a le pouvoir d’exécrer cette prérogative. C’est
la théorie de la compétence exclusive.
Celle-ci se fonde sur l’interprétation de la lettre de la Constitution que sur
la volonté des constituants. L’argumentation du CE tenait en une seule phrase
« qu’il ressort des débats tant du comité consultatif
constitutionnel que du CE lors de
l’élaboration de la Constitutions que
les modalités ainsi adoptées excluent un Contrôle de Constitutionnalité de la
loi au stade de application ».
La
doctrine quant à elle était aussi très mouvementée
1-
Le
débat doctrinal sur la position du CE
Des
auteurs ont pour leurs part exprimé aussi leur point de vue sur la position de
CE.
En
1937 Achille Mestre commentant l’arrêt
Arrighi à tout dit. Raymond carré de Malberg, Maurice HAURIOU ou encore Léon
Duguit avaient mené en leur temps des
joutes verbales pour défendre ou condamner le Contrôle de Constitutionnalité
des lois par le juge administratif. S’inscrivant dans le contexte de la
IIIème république ce débat avait une
teinte, une saveur. Les légicentristes s’opposaient aux constitutionnalistes
d’alors, dont faisait partie le CE. La doctrine encourageait le juge
administratif à exercer cette nouvelle prérogative qu’était le Contrôle de Constitutionnalité
de la loi. Cependant, ce même juge considérait que cela outrepassait ses
pouvoirs. On lui demandait de piétiner les belles paroles de Montesquieu voulant que le juge soit la bouche de la loi.
Bruno
Genevois estime pour sa part que la CE refuse de devenir « le censeur de la loi ».
En
effet, avant 1958, le débat était richement nourri par des auteurs tels que
Kelsen et ceux cités plus haut. Ils se fondent sur les grands principes
juridiques, tels que la séparation des pouvoirs, le CE s’est opposé à la
majorité de cette doctrine. Solution jurisprudentielle constante, le respect du
juge face à la loi fait écho à une tradition française profondément ancrée.
Ainsi
dans sa note sous l’arrêt Arrighi en 1936, Achille Mestre déclara que « ce qui demeure interdit aux tribunaux de tous
ordres, c’est en tout circonstance une
appréciation critique de la loi, alors même que celle –ci semblerait imposée
par l’application de la constitution »
Déjà
en 1901 (CE 23-05 1901) par l’arrêt Delarue
le CE avait estimé qu’il était
incompétent pour contrôler la constitutionnalité de la loi. Comme il a été déjà
souligné le CE a vu ses prérogatives augmenter au fur et à mesure des années
mais il s’est toujours refusé à ce contrôle. Au vu de l’arrêt Arrighi, le
président Odent qualifia cette position « d’indiscutable… » Le
CE a réitéré sa position maintes fois, se dressant ainsi face à une doctrine
qu’Eisenmann reconnaissait à peu près
unanime sur ce sujet. Ce fut le cas en 1901, en 1936, en 1997 et plus récemment
à 2005. Cette position traditionnelle
correspond au modèle européen de justice
constitutionnelle. Il s’agit d’une justice constitutionnelle concentrée
et spéciale, ce qui signifie qu’une juridiction détient le monopole de la
compétence en matière de contrôle de constitutionnalité.
En
1928, Kelsen Théorisant ce modèle américain, il s’agit de confier le contrôle
de constitutionnalité de la loi à tout les juges ordinaire, une juridiction
suprême assurant la cohérence du système. Certains auteurs ont donc appelé le
CE, le Conseil Constitutionnel ou même le législateur a opté pour ce second
modèle ; sans réponse.
Léon
Duguit alla même jusqu’à proposer un recours pour excès de pouvoir contre la
loi.
Toutefois,
Jérôme Trémeau rappelle que le CE « n’a eu de cesser d’affirmer son
incompétence pour procéder à une telle vérification ».
Cette
position se fonde sur un principe
fondamental : la séparation des pouvoirs.
L’histoire
politique française explique aussi, la volonté du CE de respecter son rôle.
Durant l’ancien régime, les juges des parlements prenaient des arrêts de
règlement, ce qui leur fut interdit par la suite. L’article 5 du code civil
dispose ainsi que « il est défendu aux juges de se prononcer par voie de
disposition générale et règlementaire sur les causes qui leur sont
soumises ». En principe, le législateur vote les lois et le juge doit les
appliquer. Néanmoins, l’administration, par
ses actes devait appliquer et
respecter la loi. Le CE refusa toujours
de contrôler la loi au regard de la constitution. Jean Marc Sauvé considère lui que « c’est la conscience
qu’a le juge de sa propre légitimité qui justifie ce refus ». Le juge n’a
pas été élu par le peuple il ne peut donc remettre en cause la volonté du
peuple, transcrite par le parlement. Le
vice président du CE ajoute que ce refus traduit : « une
volonté de respecter les équilibres et les pouvoirs » le juge
administratif appartient au monde juridique, alors que le parlement appartient au monde politique. On peut aussi considérer que le CE veut
rester dans le monde juridique, le contrôle de constitutionnalité de loi
pouvant l’amener à une appréciation politique. Cet argument peut toutefois
être renversé des lors que l’on rappelle
le rôle consultatif du CE dans l’élaboration des lois. Il faut cependant
rappeler les propos d’Henrion de pansey juristes des XIIIème siècles
et XIXème siècle « juger l’administration, c’est encore
administrer ». Ces paroles pourraient être appliquées au contrôle de constitutionnalité de la loi :
« juger la loi, c’est encore légiférer ».
Par
ailleurs, jusqu’en 1946 voire 1958 l’univers juridique français obéissait à un
principe: le légicentrisme. La loi expression de la volonté générale ne pouvait
être remise en cause par le juge.
En
plus dans son exposé de synthèse par Jean Mar Sauve, il déclarait « si
large qu’ait été […] l’extension des pouvoirs du juge dans l’interprétation de
la loi, elle ne saurait aller jamais jusqu’à priver de force un acte législatif
[…] les règles de droit dégagées par une forte jurisprudence ont tôt au tard
[…] même en dehors de leur domaine, une influence salutaire et comme une sorte d’irradiation. C’est le
seul rôle, selon nous, qu’en l’état du droit puisse avoir votre jurisprudence
en dehors du domaine qui vous est propre, des actes administratifs (confère
conclusion Latournerie sur CE 6 novembre 1936, Arrighi et Dame veuve Coudert,
Dalloz 1938.3.1 note Eisenmann).
Le
président Latournerie, en concluant ainsi sur les arrêts Arrighi et Dame Veuve
Coudert exprimait avec force le rôle que le juge administratif entendait alors
être le sien dans le domaine du contrôle de constitutionnalité des lois.
Le
doyen Vedel soulignait que le Conseil Constitutionnel, comme le CE et à
certains égard la Cour de Cassation est bien « une juridiction spécialisée,
juge d’attribution, souverain dans l’exercice de sa compétence mais non une
cour suprême polyvalente ».
Mais
l’évolution du droit donne tort désormais à tous les auteurs. Les vérités
d’antan se sont plus celles d’aujourd’hui. Les fonctions et pouvoirs du juge
administratif ont grandement évolué. De la fin du référé législatif à
l’acceptation du Contrôle de Conventionalité de la loi, l’office du juge
administratif n’est plus celui qu’il était avant. Se refusant d’abord à devenir
le censeur de la loi selon l’expression de Bruno Genevois, il accepte de
devenir petit à petit le protecteur des droits fondamentaux. L’avènement de la
question prioritaire de constitutionnalité marqua la fin du débat.
B- La
fonction de juge constitutionnel pratiqué
Longtemps
attendue, souvent redoutée la question prioritaire de constitutionnalité a été
introduite en droit français par la révision constitutionnelle du 23 Juillet
2008, définie dans ses modalités par la
loi organique du 10 Décembre 2009, validée par la décision du Conseil Constitutionnelle
du 3 Décembre 2009 et est entrée en application le 1er Mars 2010.
Sans doute une révolution juridique qui devrait marquer l’avènement d’une
culture de la Constitution dans un pays pétri par la culture de la loi. Nous
étudierons d’une part la constitutionnalisation de la QPC (1) et d’autre part
la condition de mise en œuvre de la QPC (2).
1-
LA
CONSTITUTIONNALISATION DE LA QPC
La
question prioritaire de constitutionnalité est le droit reconnu à toute
personne qui est partie à un procès ou une instance de soutenir qu’une
disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la
constitution garantit. Si les conditions de recevabilité de la question sont
réunies, il appartient au Conseil Constitutionnel, saisi sur renvoi par le CE
ou la Cour de Cassation de se prononcer et le cas échéant, d’abroger la
disposition législative. La question prioritaire de constitutionnalité à
été instaurée par la réforme
constitutionnelle du 23 Juillet 2008. Avant la réforme, il n’était pas possible
de contester la conformité à la Constitution d’une loi déjà
entrée en vigueur.
La
QPC n’est pas un recours direct. Elle donne au justiciable le droit de soulever
une question de constitutionnalité devant le juge ordinaire. En d’autres
termes, la constitutionnalité d’une loi
ne peut être contestée qu’à l’occasion de son application contentieuse à un cas
particulier. Le titulaire de ce nouveau
pouvoir est ainsi le justiciable, catégorie plus large que le citoyen
puisqu’elle comprend toute partie à une instance soit des personnes physiques,
morales etc.
Et
puisque ce nouveau pouvoir est donné au justiciable, il peut l’utiliser devant
n’importe quelle juridiction et à n’importe quel moment de la procédure
juridictionnelle en cours. La loi organique prévoit en effet, qu’une QPC peut
être soulevée devant toute juridiction relevant du CE ou de la Cour de Cassation,
couvrant ainsi toutes les juridictions de première instance, de droit commun,
Tribunal d’Instance, Tribunal Administratif ou spécialisées.
La
CE en acceptant par l’arrêt Nicolo d’écarter l’application d’une loi
postérieure contraire à un engagement international, il s’est engagé dans la voie d’un Contrôle de Constitutionnalité
indirect de la loi promulguée. À l’égard de l’exercice du Contrôle de Constitutionnalité,
le CE depuis l’arrêt Arrighi distingue deux hypothèses.
Avant
la reforme, il n’était pas possible de contester la conformité à la Constitution d’une loi déjà entrée en vigueur.
Désormais,
les justiciables jouissent de ce nouveau
droit en application de l’article 61-1 de la Constitution.
Cet
article dispose: « lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant
une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte
aux droits et libertés que la constitution garantit, le Conseil Constitutionnel
peut être saisi de cette question sur le renvoi du CE ou de la Cour de Cassation
qui se prononce dans un délai déterminé ». Le deuxième alinéa de l’article
62 prévoit qu’« une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le
fondement de l’article 61-1 est abrogée à
compter de la publication de la décision du Conseil Constitutionnel ou
d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil Constitutionnel
détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la
disparition a produits sont susceptibles d’être remis an cause».
Le
CE exerce comme prévu un double filtre. En effet le juge doit confronter les
questions prioritaires de constitutionnalité à des critères afin de décider de
les adresser ou non du Conseil Constitutionnel. Le juge doit apprécier
notamment le caractère sérieux de la question, ce qui l’amène irrémédiablement
à effectuer un pré-contrôle de constitutionnalité.
Contrairement
au juge administratif ordinaire qui doit vérifier que la question n’est pas
dénuée de caractère sérieux le CE doit apprécier la question qui lui est posée
dans le fond. Contrairement au juge
administratif ordinaire, la CE ne doit pas être le « juge de l’évidence ».
Il doit donc interpréter la Constitution et la loi afin d’évaluer la conformité
de la seconde à la première.
Les
lois pouvant faire l’objet de la QPC sont seulement les dispositions législative. Il s’agit des
textes votés par parlement : lois et lois organiques ainsi que les
ordonnances ratifiées par le parlement. La QPC peut être soulevée à l’encontre
de toute disposition législative quelle que soit la date de sa
promulgation ; même les dispositions législatives antérieures à l’entrée
en vigueur de la Constitution du 4 Octobre 1958 entrent dans le cadre de la nouvelle procédure.
En
revanche, d’autres textes votés par le parlement comme les règlements des assemblées ou certaines
résolutions, n’entrent pas dans le champ de la QPC.
De
même, les décrets, les arrêtés ou les décisions individuelles ne peuvent faire
l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité. Ce sont des actes
administratifs dont le contrôle de constitutionnalité relève du CE. Il en va
ainsi par exemple des dispositions d’une ordonnance n’ayant pas fait l’objet
d’une ratification par le parlement et qui conserve, de ce fait un caractère
règlementaire (CE, 11 mars 2011 M. Alexandre)
Bref
la question prioritaire de constitutionnalité née de la révision
constitutionnelle de 2008, entrée en vigueur le 1er Mars 2010 a permis de renouveler l’eternel
débat. L’administratif est devenu le filtre de la question prioritaire de
constitutionnalité ce qui l’a mené sur un terrain qui l’embrasse selon Laurent Seurot : la constitutionnalité
de la loi. Mais la question prioritaire de constitutionnalité est soumise à des
critères très important pour sa mise en œuvre par le CE ou autres juridictions.
2-Les conditions de
mise en œuvre de la QPC
Toute
question de constitutionnalité soulevée par la justiciable ne conduit pas automatiquement
à la saisine du Conseil Constitutionnel. Il faut que la question ait « un
caractère sérieux » et la loi organique a confié la responsabilité d’en
décider aux juges judicaires et administratifs. Par ce filtre le législateur à
voulu éviter l’engorgement du Conseil Constitutionnel ; mais ce faisant,
il a mis le juges ordinaires en situation d’exercer un pré-Contrôle de Constitutionnalité.
Il est impossible, en effet, de décider du caractère sérieux ou non d’une question sans porter un
jugement, même rapide, sur la constitutionnalité de la disposition législatif
contestée. Ce n’est pas affaire d’homme ou de volonté politique mais de
nécessité logique : si le caractère sérieux vise à écarter les questions
fantaisistes et le recours dilatoire, si le caractère sérieux d’une QPC doit
s’entendre comme étant de nature à faire naître un doute dans un esprit
éclairé, ce doute naît nécessairement d’une appréciation portée par le juge sur
la constitutionnalité qui lui parait discutable, incertaine, litigieuse de la
disposition législative critiquée.
Les
premières décisions en font la démonstration. Dans son arrêt du 16 Avril 2010, le CE juge qu’il n’est pas
sérieux de contester la constitutionnalité de son organisation interne alors
que la coexistence en son sein de fonctions administrative et juridictionnelles
est régulièrement discutée au regard des règles du procès équitable et que les
pouvoirs publics, pour diminuer le risque l’inconstitutionnalité, procèdent à
des aménagements successifs de cette coexistence ;dans son arrêt du 19 Mai
2010, il juge que la disposition législative à la gestion des comptes des
détenus « n’a pas par lui- même et ne saurait avoir pour effet
d’imposer aux personnes prévenues un prélèvement définitif de leurs avoirs au
profit des parties civils et des créanciers d’aliments » et n’est donc pas
contraire au principe de la présomption d’innocence et que par la suite la
question soulevée n’est pas sérieuse. Dans la même logique, la Cour de Cassation,
dans son arrêt du 7 Mai 2010, a jugé que « l’infraction de
contestation de crimes contre l’humanité ne port pas atteinte aux principes
constitutionnelles de liberté
d’expression et d’opinion » alors pour tant qu’un soupçon
d’inconstitutionnalité pèse sur la loi Gayssot depuis son adoption en 1990.
Dans ces trois arrêts, les cours suprêmes se font juges directs et immédiats dans la
constitutionnalité en se livrant à une interprétation de la disposition législative
contestée comme le ferait le C.C. s’il
était saisis.
Mais
précisément, il ne l’est pas « sans qu’il soit besoin de renvoyer au
C.C » dit le CE car les cours ont fait une interprétation de la loi qui la
rend, selon elles, conforme à la Constitution et fait ainsi perdre à la QPC
sont caractère sérieux.
Sans
doute pour décider du caractère sérieux de la contestation les juges
ordinaires doivent nécessairement,
procéder à une analyse de constitutionnalité, mais ils avaient le choix entre
une analyse qui conduisait à faire naître un doute sur la constitutionnalité de
la loi et donc, sans aller plus avant, à saisir le Conseil Constitutionnel et
une analyse qui conduisait à faire une
interprétation constitutionnelle de la loi et donc à ne pas saisir le Conseil.
Cour de Cassation et CE semblent avoir choisi pour l’instant, la seconde voie.
Au niveau des cours
suprêmes, l’appréciation du caractère sérieux de la question de
constitutionnalité est complétée par
celle de son caractère « nouveau ». La loi organique ayant, en effet
prévu deux filtres, les conditions de
recevabilité d’une QPC sont examinées
deux fois ; une fois par le juge a quo et une fois par sa cour suprême.
Pour distinguer le premier du second et le rendre utile, il est donc demandé aux
cours suprême de dire si la question constitutionnelle soulevée est nouvelle.
Mais ce faisant, le second filtre est plus lâche que le premier puisqu’une
question constitutionnelle pourrait ne pas être sérieuse mais nouvelle.
Par exemple, parce que la disposition
législative contesté n’a jamais été examiné au regard du prince constitutionnel
invoqué à l’appui de la QPC, ou parce
que le principe invoqué à l’appui de la QPC, ou parce que le principe
invoqué n’a pas encore été reconnu
constitutionnel par le Conseil. Il est exigé qu’un justiciable ne puisse
invoquer à l’appui d’une QPC que les droits et libertés que garantit la Constitution.
A l’évidence ,peuvent
être invoqués à l’appui d’une QPC tous
les droits et libertés de fond que le Conseil Constitutionnel à
progressivement, « découverts» dans la Déclaration de 1789 et le
préambule de 1946 :liberté individuelle, liberté d’aller et venir,
droit à la sureté, invisibilité du
domicile, droit au respect, la vie privée, droit de propriété, liberté
d’entreprendre, liberté constitutionnelle, liberté d’opinion, liberté syndical,
droit de grève, droit à la santé, droit à l’égalité…Quelque soit le support
juridique de ces droits et libertés
écrit constitutionnel, principe à valeur constitutionnel, principe
fondamental reconnu par les lois de la
république, principe particulière nécessaire à notre temps, ils protège les
individus dans l’exercice de leurs activités civiles ,politiques et sociales,
ils définissent et constituent le fondement du vivre ensemble, et à ce double
titre leur respect s’impose au
législateur.
Moins évidente en revanche est l’inclusion dans le bloc de
constitutionnalité propre à la QPC de trois catégories de textes.
D’abord, la charte de
l’environnement :sans doute ,comme l’a connu le conseil dans sa
décision du 19 juin 2008,toutes ses
dispositions ont valeur constitutionnelle ;mais certaines sont des droits « droit de vivre dans un
environnement et de participer à
l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur
l’environnement » ; « devoir de la personne de contribuer à
la réparation des dommages qu’elle
cause à l’environnement ».Si les
dispositions de la charte qu’énoncent
des droits sont évidement invocables
dans le cadre d’une QPC, celles que déterminent des devoirs pourraient ne pas
l’être. Pour qu’il en soit autrement, le juge devra considérer que l’atteinte à un droit est la
conséquence nécessaire d’un manquement à un devoir constitutionnel et qu’en
conséquence ce manquement peut être invoqué à l’appui d’une QPC.
En revanche, un devoir
pourra toujours être invoqué dans le débat
contradictoire par la partie qui s’oppose à la QPC.
Ensuite, certains
principes difficilement classables dans la catégorie principe de fond ou
principe de procédure. Ainsi des principes de précaution, d’indivisibilité de
la République ou de séparation des pouvoirs. De valeur indiscutablement Constitutionnelle,
ces principes ont pour objet l’organisation des pouvoirs publics et le mode
d’action publique ; ils ne sont donc pas, stricto sensu, des droits de
l’homme. Pourtant le juge pourrait considérer que ces principes peuvent être
invoqués à l’appui d’une QPC dans l’exacte mesure où ils sont la condition et
la garantie des droits et libertés : le principe de séparation des
pouvoirs par exemple est une garantie pour la liberté individuelle, pour
l’indépendance de la justice, pour le droit au juge…le principe de précaution
une garantie pour le droit à la santé…
Enfin, les objectifs de
valeur constitutionnelle. De la dénomination
formelle « objectifs »le juge pourrait conclure en l’absence de
droit ; mais, matériellement, ces objectifs servent à garantir des droits : la possibilité
pour toute personne de disposer d’un logement décent garantit le droit au
développement de chacun, la lutte contre la fraude fiscale le droit à l’égalité
devant l’impôt, l’accessibilité et l’intelligibilité de la loi le droit des
sujets de droit à ne pas être soumis au risque de l’arbitraire. Dans tous ces
cas, il reviendra aux juges sous le contrôle du Conseil Constitutionnel, de
décider de l’étendue des normes constitutionnelles invocables à l’appui d’une
QPC.
Pour être recevable la
QPC doit porter sur une disposition législative en lien avec le procès
ordinaire. En effet, la QPC inclut les tiers intervenant qui peut avoir, dans
un litige opposant deux parties un intérêt propre à soulever une QPC pour
défendre tel ou tel de ses droits constitutionnels.
Et puisque ce nouveau
pouvoir est donné au justiciable, il peut l’utiliser au cours d’un procès devant n’importe quelle juridiction.
Après un d’un débat sur
l’opportunité de limiter le camp de la QPC
aux seules lois votées depuis
1958 le constituant a décidé qu’elle pourrait être soulevée à l’encontre de
toute disposition législative sans restriction temporelle, matérielle ou
formelle. Quelle que soit sa date d’adoption, quelle que soit son
contenu, quelle que soit sa forme, toute disposition législative peut donc
faire l’objet d’une QPC. Toutefois si toute loi peut faire l’objet d’une QPC,
il faut cependant que la question soit posée à
l’encontre d’une « disposition législative » c’est – à – dire
d’un ou de plusieurs articles précis, d’un alinéa d’article voire d’une phrase
et que cette disposition soit « applicable au litige ou à la procédure ou constitue le
fondement des poursuites ». Cette condition d’applicabilité a pour objet
de lier le procès constitutionnel au procès ordinaire ; la contestation ne
peut pas porter sur la constitutionnalité d’une disposition étrangère au litige
ou inutile à son règlement ; elle doit viser la disposition qui est à l’origine
du procès ordinaire et dont, pour cette raison, il est indispensable de
vérifier la constitutionnalité. Ainsi l’arrêt du 23 Avril 2010 est
significatif. Le CE sélectionne les dispositions pertinentes alors que le
requérant contestait l’article 137 de la loi de finances rectificative pour
2008, il juge que seules les dispositions du IV sont applicables au litige et
déclare irrecevable la contestation de constitutionnalité portant sur les
dispositions I ; II ; III ; V ; VI ; VII et
VIII de l’article 137.
Suivant
l’extrait du rapport effectué dans le cadre d’une recherche réalisée, le filtre
exercé par le CE entre la date de
l’entrée en vigueur de la reforme, le 1er Mais 2010 et le 31 Décembre 2012 parait très important.
Au
1er Mai 2013 (soit deux mois au delà du champ de notre étude) dans
le bilan dressé par le Conseil Constitutionnel sur son site, il apparait que
sur les 1520 dossiers adressés par le CE et la Cour Cassation au Conseil Constitutionnel,
549 proviennent du CE soit 36,1% des dossiers reçus par le Conseil Constitutionnel.
Parmi ces 549 dossiers figurent 137 décisions de renvoi (25%) et 412
décisions de non-renvoi (75%) contre 177
décisions de renvoi et 791 décisions de non renvoi en provenance de la Cour Cassation.
Il en résulte donc qu’une demande de QPC
sur quatre, qui satisfait aux conditions de recevabilité ne fait pas l’objet
d’un renvoi devant le Conseil Constitutionnel. Notons également que sur 68
décisions de censure rendues par le Conseil Constitutionnel dans la période de
notre étude trente-trois, c’est- à –dire
la moitié ont pour origine un renvoi du CE (certaines décisions ont
cependant à la fois fait l’objet d’un renvoi
de la Cour de Cassation, ce qui
est le cas par exemple de la décision 135/140 QPC du 9 Juin 2011,
hospitalisation d’office).
Les
décisions de renvoi provenant du CE se
repartissent de la manière suivante sur les trois années étudiées :
2010 :54 ; 2011 :42 ; 2012 – 1er Mars
2013 : 41
Fin
2012, Jean-Marc Sauvé et Bernard stirn notent un infléchissement du nombre de
QPC posées (confère J.M Sauvé et B. Stirn, « Bilan de la question
prioritaire de constitutionnalité », Audition par la commission des lois
de l’Assemblée nationale, 21 Novembre 2012). La diminution du nombre de renvoi
depuis le second semestre 2012, ne peut être recherchée dans un durcissement du
filtrage exercé par la juridiction
administration suprême. Si un
resserrement du filtrage à bien eu lieu en ce qui concerne en particulier
l’application de la question, il s’est opéré des septembre 2010. Ces auteurs
relèvent également que deux tiers des QPC posées le sont directement devant le CE, ce qui est un point important à
la souligner en regard au fait que la question de l’opportunité d’un
double filtre a été soulevé.
Le
contentieux de la constitutionnalité n’a jamais été étranger aux juridictions administratives (voir
notamment L. Favoreux, TH. Remoux. Le contentieux constitutionnel des actes
administratif, Sirey, 1992, 206 p. ; B.Genevois « la constitution et
le juge administratif »in B.Mathieu (Dir), 1958-2008, cinquantième
anniversaire de la constitution française, Dalloz 2008. P. 355). En effet, le
CE est juge de la constitutionnalité des actes administratifs et dispose
également du pouvoir contrôler les lois du pays considérés comme étant des
actes administratifs aussi. Avec l’entrée en vigueur de la QPC, la difficulté
rencontrée par le juge administratif et le CE en particulier dans l’exercice de
la compétence de juge du filtre est donc de ne pas empiéter sur l’office du
C.C. Le CE doit donc faire preuve de retenue pour ne pas exercer une compétence
qu’il a la capacité de pratiquer même s’il en a pas l’habitation
constitutionnelle.
Par
ce bilan donc, il est possible d’affirmer qu’avec cette réforme
constitutionnelle de 2008, le CE exerce la fonction de juge constitutionnel.
CONCLUSION
Nous venons d’étudier
le Conseil d’Etat dans toute sa plénitude dés son origine jusqu’à nos jours.
Traditionnellement, le Conseil d’Etat accepté dans sa fonction consultative
était chargé de conseiller le
gouvernement et plus tard le parlement depuis la récente réforme.
Progressivement, le
Conseil d’Etat qui refusa d’être le censeur de la loi dans sa fonction
contentieuse finit par devenir le protecteur des droits fondamentaux.
Le Conseil d’Etat de
part la réforme de 2008, est un censeur partiel, un juge constitutionnel
partiel dans l’exercice de la QPC.
Au vu de tout ce
parcours bien qu’épineux et plein de balbutiement, l’on peut affirmer
valablement que le Conseil d’Etat est aujourd’hui un juge constitutionnel
indirect.
©
KUATEWO Dela Mathilde

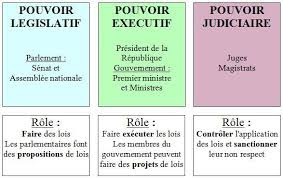


Commentaires
Enregistrer un commentaire